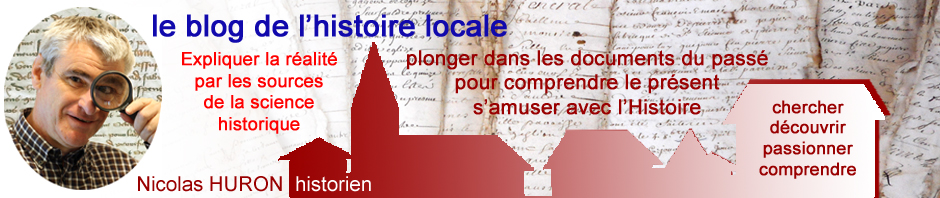Gras all…
La toponymie, géographie de l’Histoire
une science insultée en corps encore
sous Occupation fachiste et nazie
organisée par les marchands du Temple…
ici ressuscitée, pour vous ?
avec vous ?
Dans l’ordre chronologique
des grandes invasions qui ont
falsifié et sali les toponymes de mon pays…
pour, d’expériences, en reconstruire un entendement de base.
Un historique orthographique ?
Les pièges orthographiques…
Presque tous fixés orthographiquement, les toponymes, qui peuvent, dans une autre langue, prendre une autre forme écrite (en bandits bretons importés et en français parisien germain romanisé ; en occitan wisigothique menteur et en royal et aimable tourangeau de saint Martin ; etc.), ont chacun un historique propre dans leur fixation écrite : cartographies, panneaux routiers, cadastres, actes notariés, adresses postales, guides… Le problème est que la lettre tue l’esprit.
Ainsi les Aix-d’Angillon (Cher ; 18) que chaque Français aurait envie de prononcer les Ex-d’Angions se prononce L’aisé-d’Angilon, car il semble avoir eu pour origine « les haies Dom Gilon ». Mais l’attraction d’Aix-la-Chapelle et d’Aix-en-Provence lui a offert l’occasion de moins de banalités en Rians.
Le piège orthographique peut être plus subtil encore, par exemple avec Chârost (Cher ; 18) à voir ci-dessous… ou en Blésois, à Blois, chez moi, dont lequel on entend le clapotis de l’envol d’un cygne, ou d’une oie migratrice, si on prend le temps de l’entendre se répéter,
dans mon joli sablier ligérien…
êcha… ἦχα, v. ἄγω
êch, êch, êch…
Eh cake cake ?
ex, ex, ex…
Aix, Aix, Aix…
Aie et haies… hé, hé, hé…
Une exception ? Oooh NOM !
…
…
Orthographe ou phonétique ?
L’une mémoire de l’autre…
La transcription phonétique des noms de lieux, leur fixation écrite, fut et fit leur transmission dans le monde entier, pour en devenir un jeu de restauration et de renaissance du Vivant, de l’Esprit, de par le Père, Dieu le Père, dieu le père… sans doute le Dis Pater gallo-romain et par César et ses bibliothèques publiques.
Dit « euh » le perd… pour en entendre les coupables…
(((((( et leurs rythmes infernaux ))))))
C’est toujours un peu secoué et très dense…
Croyez-en Saint-Hippolyte, syn-typo-lith, sint-ypo-lyt, etc.
Illustration qu’il suffit de constater dans Le Grand Bailly
et par la cartographie… car le squelette romain du
Félix Gaffiot n’y suffit, hélas, pas,
mais a de bons restes…
Cependant qui n’entend pas ?
Hiiiii, pol, pol, pol, p’eau’l, Paul, it’
Film western complet français Chino Charles Bronson – YouTube
à voir et à entendre à 21:08 avec comme son supplémentaire
en même temps celui-ci : Bellac plage – YouTube
vidéo où on peut voir les chevaux oxygéner l’eau saumâtre,
pour enfin comprendre ma propre faune-éthique phonétique propre…
…
Un fait des clercs et de l’administration de
l’Église catholique romaine
De grands mouvements administratifs ont amené à la fixation orthographique des toponymes pour des questions juridiques et pratiques de communication. Cette fixation fut évidemment d’origine catholique romaine, souvent par la voix et la voie royale, mais le plus souvent par l’Église notamment à travers la Réforme grégorienne qui amena, à la suite des inventaires de sauvegarde des biens d’Église pendant les invasions normandes, le foisonnement des textes de restitution desdits biens d’Église auprès de la nouvelle noblesse mafieuse féodale usurpatrice qui se mit en place pendant ces périodes de guerres. Les astuces juridiques des XIIe et XIIIe siècles sont les plus élaborées dans ce domaine, complices ou/et piégeantes.
Comme la langue administrative était le latin, les premières mentions écrites de nombre de toponymes sont souvent des adaptations en latin médiéval du Moyen Age classique. Vous pouvez découvrir les pièges trompeurs de cette latinisation à travers mon article sur le sujet (La latinisation médiévale des toponymes). Ces pièges trompent encore la plupart des auteurs traitant de toponymie.
Une cartographie royale militaire
et une administration d’aventures…
Les grandes administrations qui ont apporté cette fixation orthographique sont surtout l’Église catholique romaine, la royauté et ses agents, et la noblesse, à travers leurs actes et leurs cartographies, mais aussi la bourgeoisie des parlements, des marchands et des notaires. Les plans des grandes villes et gros bourgs se popularisent dès le XVIe siècle. Il faut préciser qu’au XVIIe et au XVIIIe siècles l’orthographe des toponymes est encore très variée et qu’un même nom de lieu peut avoir, dans un même document, plusieurs orthographes.
Un fait décisif fut la cartographie royale du royaume de France, que Louis XIV ordonna de faire le plus précisément possible, et à sa suite Louis XV et Louis XVI (par les Cassini). Cette cartographie fut surtout popularisée par sa privatisation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette cartographie fut d’usage fréquent et d’importance car publiée et consultée encore par le plus grand nombre.
Les grandes administrations ?
Une usurpation républicaine et barbare…
À partir de la Révolution française (un fait terroriste anglais), cette fixation s’est faite avec l’établissement des listes des expropriations et des usurpations, puis l’établissement des cadastres napoléoniens et post napoléoniens, les obligations écrites préfectorales, l’administration postale, l’administration municipale, la cartographie militaire d’État major, puis bien plus tardivement, au XIXe siècle, les panneaux des rues, les panneaux indicateurs, dans les campagnes avec ceux des gares très nombreuses des chemins de fer, puis à travers les panneaux Michelin et les guides Michelin avec le développement du tourisme automobile, la popularisation des cartes d’État major par l’IGN (Institut national de Géographie), les consultations des cadastres…
Et nous voici devant des millions de noms de lieux, qui ont tous leur histoire écrite propre et qui ont tant de secrets à nous révéler sur mon royaume disparu, celui de l’Académie des Sciences, celui de mon patrimoine rural.
Quelques cas et régions exemplaires
Des régions sont d’une tristesse effroyable. La Vendée, après les Guerres de Religion, et après son fameux génocide révolutionnaire (qui s’est fait partout ailleurs un peu plus doucettement cruellement) de collabos anglais perpétrés par des terroristes anglais, n’est plus qu’un squelette toponymique, dans un parcellaire qui autrefois contenait des milliers de noms de lieux par paroisse. Croyez-en mon étude des noms de lieux de Tillières (Maine-et-Loire, 49, en limite de la Loire-Atlantique) à comparer avec les environs du Puy-du-Fou que j’avais commencé à entreprendre… avec tous ces noms en -ière, hier, signifiant « sacrée ».
La région d’origine de mes ancêtres paysans est encore plus effroyable, non seulement, c’est un squelette, un désert agricole de dévoués esclaves des Siècles des Siècles, mais c’est en plus un festival de blagues belges affreuses, cyniques et désespérées, souvent un peu « sale as » (Fin d’une controverse : la Beauce et ces toponymes –ville). Terre de tous les deuils… et de toutes les duretés. Votre baptême ! Autrefois faite pour le porc d’Ostie ou pour le limes romain et ses précieux Germains, et aujourd’hui à la solde des putains du monde entier via la Normandie. Une belle dalle en calcaire cristallin plus dure que le granit breton et moins poétique que mon granit armoricain ! Quoique…
Fermez la porte et fermez-la !
Moutiers-en-Beauce (28), église Saint-Jean-Baptiste, pour Mondonville-Sainte-Barbe !
Tombeau de votre sapeur pompier volontaire, de vos fourrages et de vos blés,
d’où ce présent géant vous regarde encore et en corps…
Photo Nicolas Huron sous la pluie…
Mort à l’angle Lée !
Pour la libération de tous les Savoirs !
…
Phonétique ou faune éthique ?
Parmi les 89 Aix des toponymes de mes inventaires, Aix-la Chapelle nous parle de saint Martin de Tours, et Aix-en-Provence de l’occupation romaine, tout comme l’Île-d’Aix nous parle de leurs déportations et villégiatures tortionnaires, comme Aix-les-Bains, alors que les Aix-d’Angillon, sous influence, plutôt à comprendre comme les Haies-Dent-Gilon, évoquent plutôt la barbarie champêtre, non loin de Sainte-Solange (Cher ; 18).
Alors qu’elles peuvent se montrer si nourrissantes à tous les peuples d’ici…
L’ignorance et le mépris transmettent parfois mieux que la conservation et que la préservation. L’Histoire de chacun peut maintenant commencer, avec leur singularité plurielle et leur pluriel singulier, leurs évocations phonétiques de faune éthique, leurs spiritualités et leurs temporalités, leurs poésies et les pertes d’ici-bas…
Alors qu’elles peuvent se montrer si nourrissantes à tous les peuples d’ici…
On pourrait penser que cette barbarie finisse par se fatiguer. Non, d’autres modes récentes de destructions et d’usurpation sont apparues avec la falsification des toponymes : les armoiries communales, les gentilés…
Des insultes de plus, des crachats, car on a toujours dit :
les gens d’Herbault, les gens de Françay…
Ils voudraient faire passer cela pour de l’hôte en tiques…
Ils s’inventent ainsi depuis longtemps de jolis maquillages, et, non plus des châteaux en Espagne, mais des usurpations espagnoles en France, voire pire. Sont-ils de si mauvais père au point d’en avoir été chassés ? De mauvais pairs de mauvaises paires ?
Leur propre pays en aurait-il été complètement détruit d’eux-mêmes ?
Île de Pâques ? Dodos de l’Île Bourbon…
…
Sens perdus ou science usurpée ?
La plupart des toponymes ont perdu leur sens originel. Je l’ai constaté moi-même, ma vie durant. On assiste dans ce domaine éditorial à un tâtonnement certain quand les recherches sont sérieuses, ou bien à un copié-collé outrancièrement stupide et presque industriel issu d’une tromperie et d’une usurpation germano-italienne (nazie et fachiste ? prussienne ? ostrogothique ? voire ottomane, auto-mâne ? peut-être même barbaresque ?) souvent suisse et faussement savante et très p(h)arisienne… bâclée, barbare, absolument idiote et centrée stupidement sur les noms de personnes germaniques, le plus souvent médiévales ou romaines antiques. Cette science annexe de l’Histoire, la toponymie, semble encore sous Occupation… Il suffit pour s’en rendre compte de lire quelques bibliographies et de s’équiper de quelques ouvrages spécialisés.
Qui firent aussi les toponymes… et la toponymie…
…
Un sens perdus ou des sens perdus ?
Certains sens sont si anciens qu’on ne saurait les dater… d’autres sont d’aujourd’hui.
Saint-Bernard ou syn-berne-art ? Saint-Plantaire ou syn-plant-ther ?
Geay (Charentes-Maritime ; 17) ? Geais ? Chaînée ?
J’ai jet geai…
gai guet gué…
γῆ Γῆ
T’erre ? TERRE !
Simple en terre s’implante aire… ou Saint-Plantaire, quoique…
Un refus de consulter le paysage, sa cartographie,
un dictionnaire, un ouvrage spécialisé ?
Des noms de lieux sans raisons locales ?
Faites-en une saine occupation de libération,
mais surtout, aller étudier le terrain de mes terroirs…
en oubliant un peu l’heure équatoriale suisse… faussement luxueuse,
sachant que Berne vue du côté français, c’est un peu… aunaie et phallique…
nous ayant probablement affublés utilement du verbe du premier groupe « berner »…
…
La toponymie
un chas qui ne dort que d’un œil…
Dun -euil ? D’un nœud yeux !
Les tenants actuels de la toponymie, cette science récente née dans les années 60, ne font pas vraiment de recherches paysagères, territoriales, de terroirs. Il s’agit généralement de rats de bibliothèques, et assez peu de consulteurs d’archives anciennes, et jamais de véritables géographes, ni d’authentiques diplomatistes. Quant à ceux qui s’intéressent vraiment à comprendre et à visiter sur le terrain, voire cartographiquement, la transparence historique et préhistorique des terroirs lisibles dans les toponymes, ils sont à inventer. La plupart sont actuellement sur un pendant linguistique…
qu’oreille hors aille
en eaux rayent et orée -ill’œufs
et bla, bla, bla… très cryptogamique, souterrain… sous tes reins… ?
Alors que, par exemple, « Chârost » (Cher ; 18) nous fait entendre un mammouth
projetant l’eau de sa trompe, Chhââ… puis entonnant son puissant infra son Rôô…
Est-ce de la linguistique en singularité plurielle ou de la phonétique faune-éthique ?
Mais peut-être n’est-ce qu’un char Ω, chas r’ω, char eaux, char haut, chas rôt…
Mais peut-être que Chârost est le ronronnement plaisant d’un gros chat gras,
précédé de son feulement, voire d’un chas souterrain…
uniquement audible par un sourcier…
qu’on priverait de son eu
U nu.
Les leçons de choses du descendant d’expérience, et de sang, que je suis de la paysannerie et de l’artisanat français, se montreraient-elles nécessaires et indispensables, dans un temps où la vie sur terre, voire en mer, est en danger mortel absolu d’une totale invasion parasite tyrannique, totalitaire, exterminatrice, digne de celle des insectes Elaeidobius kamerunicus, charançons curculionidae, uniques pollinisateurs du palmier, introduits pour grouiller, tout broyer et tout brouiller (brouter ? déjà que le mouton de l’Himalaya… et ses chiens…) en Asie du Sud-Est en 1981 pendant les années Mitterrand, de Vichy ? Intéressé par l’apha et l’oméga ? Par le chant du coq ? Ô a ? Ne voyez-vous pas que le « g » grec, γ, est comme le Christ sur la Croix ? Essoré ? Lessivé ? INRI ? Un miroir d’eau pour cet asiatique Himalayen passé par l’Égypte via l’Océan Indien, tout comme saint Georges ? Ou bien, par l’erre out de la soie ? « Il y a pire que les Loups » aurait-il dit. Oui, oui (« mouton » en Gaulois), il savait de quoi il parlait, en grec.
ᾤα ?
γ α
Ω
ω
Liste ?
Lisse T…
Sot si halle ?
33 au Zyclon B ?
3 pattes et 3 pattes ?
6 pattes + 2 ailes eues ?
imprégnés et marqués à vie,
ils en mangent autant qu’ils en respirent…
Mythe errant ? Mis tes rangs ? Mites errent en… ?
Dimanche des Rameaux ? Dimanche des palmes ? Palmes des martyres ?
Moins ? Mou… oint… Mmm OUiiinnn… Hmm où Huns…
ἄω ? ἄω ? ἀῶ ? ἠώς ? Ἠώς ?
…
L’apocalypse, selon son sens étymologique, doit être effective dans ce domaine essentiel à la compréhension de la géographie et du fonctionnement du Vivant ici-bas. Ce blog et mes recherches ont refait ces découvertes de façons originales par la relecture et la redécouverte de la singularité plurielle et du pluriel singulier des noms de lieux de mon pays, de leur phonétique faune-éthique…
…
La phonétique de la faune éthique…
qui fait entrer la Préhistoire dans l’Histoire…
Châteaudun ? Château d’Hun ? Chatte aux daims ? κατ·ώδυνος !
Revisitez-en la Grotte du Foulon avec château et Ô d’Un…
et ses rognons de silex… qu’on dit en fer par ici. Enfer !
Avant l’arrivée des Celtes, avant les Danubiens, avant Cro-Magnon…
Les noms des mégalithes pré-celtiques, comme les dolmens ou les menhirs, sont le plus souvent d’origine romaine, médiévale ou moderne. Certains ont gardé des traces de leurs origines préhistoriques : Lay, Lée, Chiron…
C’est une usurpation des préhistoriens… détrousseurs de tombes…
Autrefois, quelques rares noms de lieux étaient soupçonnés d’être pré-celtiques, c’est-à-dire de dater d’avant l’arrivée des peuples celtes, peuples de l’Est. Ces noms sont souvent des méga toponymes : fleuve comme la Loire, région comme la Beauce… Ils étaient autrefois reconnus dans quelques toponymes de rivière, voire parfois dans quelques micros toponymes du parcellaire.
C’est une usurpation des prétendus Gaulois… souvent nationalistes…
dont on ne sait la nation gauloise d’Europe orientale ou d’Asie centrale.
Dans les faits, quand on cherche bien, les noms préhistoriques sont nombreux. En attestent mes longues enquêtes sur Chârost, Diou, Cyr et les Saint-Cyr, Bernard et les Saint-Bernard, Hippolyte et les Saint-Hippolyte, etc. et quelques toponymes uniques comme Oisly, Saint-Plantaire, etc.
Mes articles les plus récents vous font part de ces explorations nouvelles de relecture en faune-éthique, vérifications faites, pour consolider ces constats après avoir redécouvert les sens pluriels et incroyables du toponyme de Saint-Cyr-en-Bourg (Maine-et-Loire ; 49) en plongeant dans le grec ancien et dans les langues gauloises.
Je vous ai fait des jeux et des modes d’emploi pour vous y mettre aussi.
C’est une saine occupation…
C’est tellement incroyable que personne ne pouvait soupçonner l’existence de cette vérité. Certains semblent aussi anciens que l’occupation humaine, car on peut y percevoir la phonétique de la faune-éthique, et en apercevoir 36 chandelles… 36 chants d’ailes… de par nos 36 phonèmes.
On en redécouvre même ainsi Blois, ma ville faune-éthiquement : Bl’, bl’, bl’, oie, oies, oies… Wouah ! Blu a… et sa plaine humide de Loire et les envols de ses oies migratrices, et pas seulement ses blés ou ses loups (Romains)… Et on en redécouvre mon Blésois, écrit aussi Blaisois… en relisant, voire en bégayant, mais surtout en ralentissant sa relecture : B’lois en B’l’aise’où’a ! « Oi » indiquant le reniflement… à en croire Oisly (41).
Dans la réalité, c’est presque infini… Mais cela a-t-il été éternel ?
En plongeant dans les dictionnaires, avec les bonnes cartes, et avec la géologie, l’hydrologie, la géographie, la géomorphologie, la paléontologie, etc., c’est encore plus riche… et compréhensible quand on naît du Vivant d’ici.
Et, on s’aperçoit que c’est à travers l’Histoire des invasions que les sens multiples et naturels s’émoussent, se perdent, changent pour parfois ne plus rien représenter. C’est ma redécouverte personnelle, ma relecture, vraie sens étymologique de « religion« , via la Méditerranée… et son paysage détruit.
Mes dits « Terre » à nés…
Φοῖνιξ Φοῖνιξ
QI cuit cuicui !
φοινιξ
hexa- exact ? eggs ah ?
Langues d’oiseaux arboricoles des cèdres…
très proches parents de l’Hoazin huppé
Phénix fait niKs
Ê-queue, ê-queue, ê-queue…
et que, et que, et que…
ék, ék, ék ; ex, ex, ex…
ἕξ ἐξ εκ
ECCE HOMO !
Termes grecs synonyme de « y avait »
transformés par humour sadique en 666,
chiffres « arabes » pris aux Hindous trompeurs,
qui ne gravaient rien en signe et place du ou des zéros…
tromperies auparavant pensées par l’écriture romaine en…
SEX SEX SEX, VI VI VI, vis vie vit, oui, oui, oui, ouïes où y huis…
Aquæ Sextiæ Aix-en-Provence pour faire colle et remonter par Briançon !
pour les Aix-d’Angillon au lieu des Haies-d’Angillon, et St-Germain à la place de St-Ithier,
et Aix-Lâch’appelle par saint Martin, légionnaire romain, en lieu et place d’Aix-l’Église.
…
Les invasions usurpatrices…
africaines, danubiennes, et autres…
Le Pitt et camp tro(u)pe ? L’homo ça Pi ins- ? Et Jean passe… avec sa « moi-se-batte » et son gros moulin de tracteur et sa benne pour le Ben cake chose… pour se tuer à récolter leur blé !
Le mouton (bélier émasculé ; viande après un bon coup de Merlin)… et son « bon » (de livraison, de réduction ou de rationnement) Pasteur des contreforts de l’Himalaya et de son Hindou Kouch (Hindou ! Couche ! Miam, mi âme… monté à crue) avec son bouc (je te tiens, tu me tiens, par là…), voire son book, et ses rôles de comédiens, pour les chèvres de son « art-aime », souvent marchand de tapis, voire marchand du Temple, du temps peu Leu (Loup en toponymie, ou autre chose…), en aurait-il retrouvé le chemin de Babylone ou celui de Pharaon et du triangle humide du Delta du Nil, voire du triangle sec du Sinaï, du triangle géant de son cher climat tropical humide ou sec et désertique et lépreux Hindou, dit sous-continent (à moitié fourré sous l’Himalaya jusqu’à l’Altaï…), vers la route des Indes de son paradis perdu, celle de l’Arabie heureuse (à comprendre, droguée, shootée… anthropophage et pêcheur), ou celle des Maldives, vers la route de ses Indo-chinois cannibales coupeurs de têtes, voire vers ses Papous nés là-bas, ou de ses Polynésiens expatriés avec les tortues sacrées chinoises retrouvées aux Galapagos, mais totalement dévorés sur l’Île de Pâques et à la découverte des Amériques, Indes du Grand Orient dont celle du Sud est bien aussi triangulaire ?
Le porc… et son ver solitaire, poison chinois, le blé et son charançon (modifié de celui du riz ou du palmier ?), poison chinois, le loup… et son Turc marchand du Temple, poison chinois, et la Louve, ROME ?
Le port… Marco Polo, et ses poisons chinois… Salpêtre de poudre à canon ? Vieux chiffons des impressions d’épidémies très prisés des Anglais, remplacés par le papier ? Incinérations ? Électromagnétisme des boussoles qui sont devenues espionnes, incarcératrices et tueuses ? Soies qui autoriseraient des sauvages modifiés à rouler en Mercedes ? Papous successivement génétiquement arrangés comme amuseurs dans ses palais orientaux ?
Tous ont formé vos marques, vos addictions ! Vos toponymes !
Eux en sont restés à leur tampons d’objets volés…
Idéogrammes ! Idées aux grammes !
Tolérance, taux laid rance…
Tôle errance…
avec un pouce fait pour montrer l’argent,
tripoter une vitre grasse de téléphone nomade,
pour quelques grammes en langue de Mamm’on(T)…
Non, rien de nouveau sous le Soleil…
…
Les invasions gauloises dites celtes
Les peuples celtes s’imposèrent comme une aristocratie guerrière, esclavagiste, entre le VIIIe et le Ve siècle avant Jésus Christ pour certains, ou entre la seconde moitié du VIe et les premières années du IVe siècle avant Jésus Christ pour d’autres, sur les peuples locaux.
La langue dite gauloise n’était pas une langue écrite puisque les druides interdisaient les récits divins ou épiques. C’était une langue qui portait en elle plusieurs sens à la fois. Pour la comptabilité, ou l’écriture spirituelle cachée, les Gaulois utilisaient l’alphabet grec. Cela transpire de partout en France à travers la toponymie qui est une science annexe de l’histoire qui permet de retrouver certains mots ou notions gauloises (Cangey, Cangé, Cangy, un nouveau mot gaulois ?).
Il est ainsi très intéressant d’étudier les toponymes anciens à travers le grec ancien en utilisant Le Grand Bailly, dictionnaire grec-français. On peut aussi aborder cette langue par d’autres biais : anthroponymie (nom de personne, à travers par exemple la Guerre des Gaules de Jules César), numismatique (monnaie), archéologie (marques sur les poteries), littérature historique à travers la Guerre des Gaules de Jules César, etc., mais il faut en connaître les reliefs et les terroirs.
La toponymie permet de retrouver la singularité de la langue des druides, terme que l’on pense composé de « drui », pour arbre (composé de trois parties : racines, tronc, houpier), pour chêne, pour droit, pour ortho…, notion encore identifiable avec Droué en Loir-et-Cher, et terme construit avec le suffixe « dès », à prononcer Dèce, mot parfois écrit Daces. Mais c’est un peu plus compliqué de cela… à farfouiller un peu dans Le Grand Bailly : dru, δρυ, ru, ρυ (couler, dire…), rui, ruid, ui, uid, υιδ, idès, dès…
Chercher si un toponyme est gaulois, nous amène souvent à découvrir des toponymes beaucoup plus anciens, de l’Âge du Bronze, du Néolithique, voire même du Paléolithique.
Les dictionnaires de la langue gauloise, qui était une langue celte comme le breton, l’irlandais ancien, ou le gallois ancien, sont rares. Nous en avons indiqués dans notre article sur la méthode et sa bibliographie. Ces dictionnaires peuvent être adéquatement complétés par l’étude du terrain en toponymie.
Un ancien nom gaulois, ne figurant pas dans ces dictionnaires, peut être déduit par l’étude, comme par exemple Cangey (Indre-et-Loire ; 37), qui pourrait signifier “coudé, cambré”, voire « terre ou gué de cannes de roseaux », etc. Il faut signaler là que chaque envahisseur comprend à sa manière la phonétique locale des noms de lieux transmises essentiellement par la masse servile locale, les esclaves, qui seuls, par leurs ouvrages, sont réellement dans la vérité locale dans un temps donné historique, en un lieu soumis.
Pour faire un trait d’humour, j’ai découvert que les Gaulois ont laissé beaucoup de toponymes au suffixe –euil (œil), et beaucoup de toponymes avec la racine bar-, en Région Région Centre, surtout en Berry et en Touraine… régions de ce point de vue assez préservées de…
…
Rome…
La Guerre des Gaules
L’invasion de la Gaule par Jules César fut extrêmement impactante sur les régions où les Romains commirent un ethnocide, comme chez les Carnutes en Beauce, ou en Champagne, et sans doute aussi chez les Bituriges en Champagne berrichonne. Dans ces zones dépeuplées, les noms gaulois ont le plus souvent presqu’entièrement disparu. On trouve aisément à la place une centuriation romaine (cherchez la vôtre : Cadastre ancien et centuriation romaine) et beaucoup de marques militaires de surveillance de frontières ou de camps de travaux forcés (cherchez les vôtres, comme Oisly, dans le 41, mais il y en a partout, et voyez ceux qui en rient… encore).
Dans des régions comme le sud du Berry, le Perche, certaines zones de la Touraine, on trouve encore de très nombreux toponymes gaulois, mais ce sont souvent des zones de marches, de frontières…
La romanisation et leurs mercenaires barbares
La romanisation a considérablement impacté la toponymie de la France, à tel point que la grande majorité des communes ont un nom d’origine romaine ou plus ou moins transformé par Rome.
Les romains introduisirent ou essayèrent d’introduire des cultures particulières : l’olivier (Olivet, l’Oliveraie ?), la vigne, de retour chez elle, autrefois sans doute arrachée par les buveurs de bières cannibales gaulois des Goths lois… qui ne veulent qu’un seul fruit dans leurs arbres fruitiers… et peu d’ombrages, car ils sont incendiaires comme le montre la Guerre des Gaules… Les cyprès des Romains, leurs Loups (loup loue).., ont été adoptés dans nos cimetières… tout comme leur trophée romain, mesure de toute chose : T… Cependant, attention ! Olivet (Loiret ; 45), que l’on pourrait croire romain avec sa source sacrée du Loiret, est aussi un haut livet ou une eau lit V, comme Montlivault (Loir-et-Cher ; 41)…
Beaucoup de toponymes ont pour origine l’appréciation du paysage par les Gallo-romains créant ainsi des noms de lieux de morphologie géographique, ou de rappel de la végétation ou des cultures. De plus, nous utilisons leur alphabet qui porte influence orthographique, voire sémantique qui s’aime en -tiques.
Le dictionnaire Félix Gaffiot reste probablement l’outil le plus utile pour les identifier, les décomposer et les analyser.
La toponymie des hameaux et des fermes est également souvent d’origine romaine dans les zones de champs ouverts. Dans les zones de bocage, ces toponymes sont le plus souvent médiévaux.
Les atrocités ou les souvenirs des atrocités de ces esclavagistes sont visibles dans des toponymes terrifiants, comme les Maisons Rouges, comme toutes les églises ses saints martyrs et des Notre-Dame… ou dans les petits recoins des Madeleines… à chaque carrefour avec calvaire où dont le calvaire a été arraché.
Arracher un calvaire, c’est en rajouter une couche…
Alors qu’une telle équerre pourrait guider automatiquement
n’importe quel véhicule…
Sont Y Bête !
Y étant la lettre G grecque, la Terre !
Un Y sur un Trop fait romain ?
Auto mobile ?
C’est Jules César qui s’est associé avec des atroces criminels nommés Germains. Ils furent, dès les débuts de l’occupation romaine associés à l’esclavagisme de la population servile locale, couche par couche, vague par vague…
Croyez-en Françay, en Loir-et-Cher, son église Notre-Dame, notre peuple, et sa Guillaumière… Cherchez un peu, là aussi, les traces de vos crimes de H(y)ènes.
Une aide digestive spirituelle ?
…
L’eau riant, l’Orient…
La christianisation
Les noms en Saint- ont souvent une origine de la fin de l’Antiquité gallo-romaine ou une origine médiévale. Il s’agit le plus souvent de christianisation de lieux de culte plus ancien.
Beaucoup de noms de lieux commençant par Saint- désigne, après enquête, tout autre chose, et nous font entrer dans la préhistoire de la phonétique de la faune éthique. Je vous suggère de découvrir cette surprenante vérité avec Saint-Plantaire (Indre ; 36), ou avec les Saint-Bernard, ou avec les Saint-Cyr (notamment Saint-Cyr-en-Bourg, en Maine-et-Loire, où j’ai fait cette découverte), ou avec les Saint-Hippolyte, etc.
Certains noms sont liés à la présence d’un édifice religieux : chapelle, celle (cella), ermitage, monastère, abbaye, etc.
…
La barbarie germanique…
qui tire toujours la couverture à soie…
Les invasions germaniques franques
De nouveaux mots vont apparaître avec l’arrivée des Francs comme “butte”, “hutte”, etc.
L’influence germanique se verra surtout sur l’anthroponymie, car à partir des Ve et VIIe siècles, la mode des noms d’origine germanique va s’imposer comme nom unique pour les habitants de l’ancienne Gaule romaine.
Beaucoup de noms de hameaux, de fermes, ou de parcelles, prendront alors le nom de leur propriétaire, un nom d’homme d’origine germanique. Ce n’est pas forcément l’homme qui a une origine germanique, mais son nom car c’en fut la mode. Cependant, après enquête, on s’aperçoit que c’est souvent le nom du lieu qui fut pris comme nom de personne pour assurer le bien de propriété. Ainsi la Bernardière, qui désigne une aulnaie sacrée, verra souvent des nobles porter le nom de Bernard en ce lieu, car il s’agit essentiellement à cette époque, d’avant l’an mil, non de patronyme, mais de surnoms.
Ces usurpations avec des noms germaniques sont innombrables dans les zones de bocages de l’ouest de la France : Bernardière, Guillaumière, Godinière (il y a des milliers). Ces usurpations sont aussi innombrables dans le milieu éditorial.
Ils concernent beaucoup de communes des environs de l’Ile-de-France, où Paris est capitale…, régions agricoles où ces toponymes sont souvent associés au terme “ville” : Ymonville, Mondonville, Hermenonville, etc., mais l’enquête nous indique souvent la présence d’un jeu de mots, assez jeux de maux… On les pense médiévaux, mais ils sont francs et datent de l’Empire romain.
Pour aborder ces noms germains, on doit se rapporter avantageusement aux ouvrages de Marie-Thérèze Morlet, qui ne fait science que des noms ou surnoms de personnes, mais dont le travail est utile pour chaque enquête topnoymique.
Les invasions normandes…
Eux aussi ont laissé des traces… Dunkerque !
Et toujours les mêmes trafics d’esclaves et de tortures…
…
Les personnalisations… médiévales
le droit complexe poly… du Moyen Age
et la dysorthographie toponymique
La naissance des noms de familles, les patronymes
La mode des noms bibliques, comme Jean, Pierre, etc., va supplanter la mode des noms germaniques à partir des environs de l’an mil. Comme le stock de noms bibliques est restreint, pour se distinguer, les gens, et surtout les Jehan, se sont donnés des surnoms qui deviendront les noms de familles, les patronymes, transmis de père en fils.
Selon une étude européenne, ces surnoms concernèrent approximativement pour un tiers des noms de lieux (Duval, Dupont, Dubreuil, etc.), pour un tiers des noms germains (Bodin, Renaud, etc.) et pour un tiers des sobriquets (Courtat, Morin, etc.) ou un nom de métier.
Mon patronyme, par exemple, Huron, est un nom de la frontière Est du Perche, et désigne notamment, une tête de cochon (hure), une personne avec des cheveux sur la tête, une sorte de crête abondante (c’est mon cas) une personne grossière et hirsute, surnom des Jacques révoltés au Moyen Age, etc. Ce surnom a donné son surnom français à la tribu amérindienne des Hurons du Canada. C’est aussi le nom d’un sapeur au Moyen Age, par le côté fouisseur de la tête de cochon. Ma famille paternelle qui l’a porté était une famille de bouchers de Trôo, portant de génération en génération les prénoms d’Edmond et d’Ernest. Le H n’en est pas muet et ne fait pas forcément liaison dans un phrasé (mon prénom complet est Nicolas Guy Ernest).
Aie de mon Huron… Air n’est-ce Turon…
Les grands défrichements
Les implantations de ces nouveaux patronymes comme toponymes se placent surtout pendant la grande période des défrichement de la seconde moitié du Moyen Age, entre la fin du XIe siècle et la fin du XIIIe siècle.
Ces défrichements ont laissé souvent de nouveaux toponymes, comme les Villeneuve, les Taille, les Arrachis, etc., mais on voit souvent, après enquête de terrain, qu’il s’agit de toponymes là encore pouvant être plus anciens.
Le XIIIe siècle
Avant la seconde moitié du XIXe siècle, beaucoup de paroisses ont eu leur maximum de peuplement au XIIIe siècle. Avec la Peste Noire et les conflits franco-anglais, puis avec les Guerres de Religion, faits de bourgeoisies marchandes, la population va décroître brutalement. Il faudra souvent attendre le XIXe siècle pour qu’une paroisse, dite aujourd’hui commune, retrouve son niveau de peuplement du XIIIe siècle.
Le Moyen Age, c’est aussi la fondation des toponymes Léproserie, Maladrerie, Sanitas, etc., qui sont parfois des dispositions anciennement romaines, et qui ont été généralement installées et gérées par l’Église catholique romaine.
Les établissements religieux ont, pendant tout le Moyen Age, considérablement impacté la toponymie : les églises paroissiales, les prieurés ruraux, les collégiales, les abbayes bénédictines, cisterciennes, l’ordre du Temple, les Hospitaliers, etc.
Des vil(l)es entières leur doivent leur existence médiévale, moderne et contemporaine : Selles-sur-Cher, Chabris, Saint-Benoît-sur-Loire…
Des réussites urbaines doivent à l’Église catholique romaine toutes leurs richesses : Tours, Châteauroux (Déols), Chartres, Bourges…
Les seigneuries, et leurs sièges, les châteaux du Moyen Age (qui datent presque tous de la seconde moitié du Moyen Age), ont été moins créatrices d’agglomérations. Ils ont cependant, de par leur autorité et leurs archives, préservé beaucoup de toponymes. Ils ont laissé quelques noms de lieux : Fossés, Tours, Remparts, etc. Ces châteaux sont toujours associés à un ou plusieurs établissements ecclésiastiques qui complètent le dispositif de défense. Quand un château est connu sur une ville, c’est la plupart du temps une fortification plus ancienne, romaine, gauloise… : Blois (41), par exemple est un ancien fort franc, comtale, donc d’autorité romaine, comme le château de Tours (37). Le château de Châtillon-sur-Indre (36) s’appelle la Tour César, et le toponyme de la ville est romain, dans un disposition datant du Ier siècle avant Jésus Christ (en partie étudié dans mon article sur les toponymes Limeray). Ce point fortifié fut sans doute probablement gaulois antérieurement car les indices sont nombreux.
Le système féodal et les droits seigneuriaux ecclésiastiques, nobiliaires ou royaux, ont également créé des noms de lieux : Censif, Fief, Justice, Pilori, Garenne, Pigeonnier, Colombier (souvent d’anciens lieux de culte romain), Fuie, etc.
Les arpentages et la création ou l’entretien du parcellaire au Moyen Age, et de la voierie qui les borne, ont aussi créé ou transmis de nombreux toponymes : Croix, Pointe, Arpents, Muids, etc.
Les cultures et pratiques agricoles médiévales ont également laissé beaucoup de toponymes : Froment, Genêt, Pré, Vignes, etc.
Les contemporains de ce siècle, le XIIIe siècle, considéraient que le monde était alors plein. Ce fut le temps des grandes cathédrales et de la naissance des administrations laïques et de la monarchie centralisée, avec Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Bel, etc. Leurs institutions ont également laissé quelques toponymes : Bailli, Bailliage, Prévôté, parfois Mairie, etc.
Au XIIIe siècle, presque tous les toponymes anciens d’une commune existaient déjà. Beaucoup de toponymes de cette période ont souvent disparu. Ils n’apparaissent pas dans les cadastres, mais on les trouve parfois dans les sources écrites anciennes, les chartes, terriers, inventaires, actes de propriétés… Les sources écrites de l’Ancien Régime, antérieures à 1789, ecclésiastiques et nobiliaires (les sources notariales, généralement des registres ou des liasses de minutes, sont assez peu inventoriées), sont à ce titre très instructives, car l’absence d’un toponyme est parfois plus intéressante à étudier qu’un toponyme qui fut inventorié sur le cadastre ancien dit napoléonien qui, cependant, reste la source essentielle de la toponymie française (Faire l’inventaire des toponymes de sa commune) car la plupart des toponymes qui y sont inventoriés datent du Moyen Age.
…
Et Montrichard, en Loir-et-Cher ?
Et toutes les seigneuries… Montrichard et son donjon roman… sa cité médiévale, son église Sainte-Croix, ses maisons à colombages…
Seulement ? Seul ment ? Seul m’en…
Montrichard n’en serait qu’une charmante cité médiévale ?
Photo Nicolas Huron
Très gras cieux, trois Grâces si œufs… en eaux…
Montrichard, monte, ris char…, mont tricha re…
Mon ont Tricha ichar char- ard… Si, relisez !
Avec Le Grand Bailly, en copiant collant : μον– (seul, mon) οντ– (en réalité, dans les faits) τριχα (en trois, par trois) avec ἴχαρ (pour επιθυμια inspiré de ἰχανάω-ῶ, s’attacher à, désirer) et avec χαρά (joie, plaisir…) et avec le verbe en final, comme dans les langues anciennes : ἄρδω, arroser (un pays, un champ) en parlant d’un cours d’eau, arroser avec quelque chose, un cours d’eau, un canal d’irrigation, etc. ; abreuver (des animaux), abreuver à l’eau d’une rivière ; se désaltérer ; et au figuratif : rafraîchir, ranimer, quelqu’un avec quelque chose (de la nourriture, du vin, etc.) ; d’où entretenir, fortifier…
avec Montparnasse au pied, juste en face… qui en anima l’aise âmes
avec trois petits ruisseaux, et le Cher… et tout son fond sableux.
Oh, mes gars, le bec dans l’eau et dans l’Ω, ω, oméga… et pas que…
Trois charmantes têtes d’animaux s’y abreuvent en corps encore…
Paisible touraine… pèlerins de Notre-Dame de Nanteuil inondable !
Et vous voici prêts à en jouer…
Jouez-en enjoués… de mon patrimoine…
et d’en boire autant que d’en manger…
Une datation ?
…
Pour aller en corps encore plus loin en char et en car :
relisez-en le Châr de Chârost (Cher ; 18)
au début de mon livret livré…
consacré.
…
Après cette €onsultation, ce « pi-âge » et cette « tu-ris »,
pour tout le « t’en… », le tant et le temps que cela m’a pris, à moi et mes aïeuls…
je peux fournir une facture pour ce « Rendez-vous ! » « sans rendez-vous !».
A vous de décider ici du montant de votre dû (dette ?).