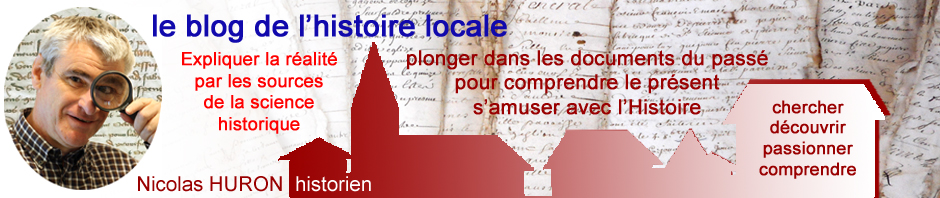et laisse avoir où les savoirs s’avouent arts… l’S à voir…
((((( À vert tisse m’en (( T )))))
Blogs et sites dédiés aux personnes instruites mais se sachant ignorantes,
aux personnes à réinstruire ou à instruire, honnêtes… et adultes
(c’est-à-dire personne ou presque, ici, depuis 2015)
étant moi-même le premier con cerné…
concert né qu’on sert nez…
pour vos enquêtes…
en quêtes…
d’Histoire !
Avertissements :
Brue et bru lues re… et brûlures relues…
Radioactivité e(s)t radio activité… Rap(pe) peur !
Veuillez vérifier que vos matériels électriques, électroniques, électromagnétiques, et
autres appareils hertziens ou réfléchissant, informatiques connus de vous ou non,
ne vous sont pas dangereusement toxiques sans ou avec ce média monopolistique.
Dans vos déplacements, stabilisez vos pieds, à cause de la déstabilisation de l’oreille interne avec toutes les (((((((!))))))… de la part de Maurice.
L’Histoire est la science de toutes et donc de tous les arts…
de tout lézard… l’aise à Rrrr’ œufs ! Areuh ?
Osez demander un rap (h)or(s), un rapport…
Osez l’Histoire !
et persévérez à apprendre à la lire
pour la comprendre et l’admettre…
Maître, est-ce… mes tresses ?
Ajouter un « est-ce… ? » Why ??? Aïe, aïe, aïe !
Sur cette page d’accueil, pour choisir votre sport spirituel,
cliquez sous le bandeau sur : Continuer la lecture…
Liste des articles de ce blog…
Le dernier article est présenté
ci-dessous en premier.
Suggestion : Joyeux Noël ((((( 2025 ))))) radioactif et bonne à né 2026… en A245 !
Restes d’hier réchauffés : anti chinoiseries bouffeuses de Saint-Bernard… avec A213 !
((((@rticles en cours de rédaction et en atelier à visiter : A214 ; A238 ; A242 ))))
…