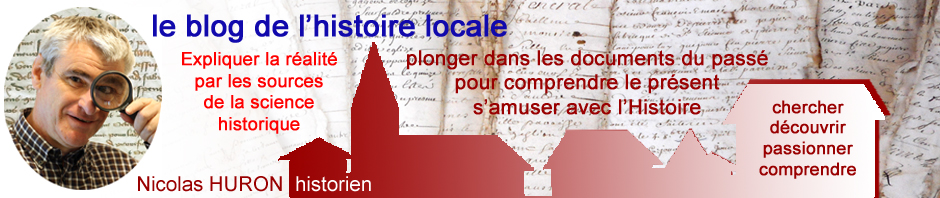Lien d’avertissements et d’enquêtes un peu entamées…
A illustrer brillamment comme vous voulez… cet article fleuve… et rivières.
Mère cure, Bourbon, Dis Pater,
Jupiter, Arès, Apollon, Charon,
Héphaïstos, Vénus…
pour comprendre cet article, il faut avoir la culture des anciens… articles.
Donc remontez un peu le cours de cette découverte apocalyptique de Chârost.
…
Liste mythologique : convergence, sédiments, lie, marc…
Outre l’évocation des animaux-totem-dieux comme le mammouth, sa trompe et son gros son, crottin s’il en naît, le poisson, α, halle fa… à défaut de baleine, le coquillage ouvert avec sa chair offerte sur sa nacre blanche, ώ, la tortue et ses écailles en forme de feuilles (La Folie, feuille, carapace, écaille, φολίς…), l’agneau à sauver, à castrer ou à égorger, le porc domestique, sanglier, sang lié, où sangle y est, copain comme cochon (Les Soudis, συώδης, évoque la gloutonnerie du porc, le sanglier sacré aux yeux des Gaulois, le fouissement, les Enfers… les non-dits… mais aussi, la force, l’entêtement, la cocasserie, la spiritualité, la gadoue, la pudeur et la modestie), le chien à Troie tète, lui, la proie et le chasseur, meilleur ami de l’Homme, le cheval, plus belle conquête de l’Homme qu’on quête, etc., outre les éléments essentiels, le ciel, le Soleil, la lumière, le roc, la terre, le feu, le sang (Milandre, et son vermeil), le lait, l’eau, etc., outre les plantes utiles ou dangereuses à l’Homme, comme le lin avec ces fleurs bleues à cinq pétales (pour voir le rapport avec la Vie, l’urgence, la gravité et sa torsion, il suffit de demander : contact !), outre les notions de cultures, d’agriculture (les Beauces, terres très anciennes), de terres, d’argile, de sables, de pots, de peaux, de faire, de fer, de protection, de sommeil et d’éveil, de passages, de chas, de gué, de pont, de traversée, de courroies, d’essieux, de chars, de roue (notamment celle des réincarnations dans les croyances gauloises, ici perçue à partir d’Issoudun, ou des anciens finages protohistoriques plus ou moins patatoïdes), de faulx, avec les notions de morts, de dés, de hasards et de destins, etc., présents dans le nom de Chârost ou dans des toponymes voisins, nous y trouvons cristallisée la culture des dieux païens et du sacré des anciens…
Une bonne paire de lunettes ? G’astronomique ?
…
Ainsi le méandre de Chârost, que tout le monde prend pour un carrefour, ou une concession à chars, est une sorte de convergence, de sédimentations, de lie, de marc de raison. Il semble s’y être cumulé à travers l’Histoire, et à travers toute la très longue Préhistoire que le nom même de Chârost fait entrer par l’écrit et les cris (de joie ?) ou les onomatopées dans l’Histoire, une quantité invraisemblable de dieux romains, gaulois, voire plus anciens encore, et des concepts cultuels chrétiens orientaux, déjà présents sur place avec un sens différent, comme Saint-Georges, le Grand Martyr anatolien, Saint-Michel, Archange (à prononcer “arc en jeu” en pensant à l’ancien dieu Apollon, à la révolution terrestre et à sa balistique observable avec ce casque, ou un crâne, voire un crâne d’œuf, tel un geai, un poisson, une tortue, une couleuvre, une grenouille, une grue…), dont les noms, aujourd’hui chrétiens catholiques romains, ont sans doute précédé ces cultes historiquement récents, nécessaires relais et sauvegarde de ce grand Tout, de ce grand fourre-tout, de ces Mondes, celtes, romains, germains, etc., et de l’Univers, c’est-à-dire, selon la définition du dictionnaire (le dictionnaire latin-français Félix Gaffiot, par exemple) : la catholicité (de katholikos, καθολικός, καθολικῶς, en grec à relire dans le dictionnaire Le Grand Bailly) généralité organisée autour de la religion, qui signifie seulement étymologiquement : relire, observer avec attention, revoir…
sans doute pour apprendre ce qui Est !
Sang doute ?
Y avait ?
…
La rue du Bourbonnais, au Grand Faubourg, évoque une rigole aboutissant à la source chaude, sacrée, de la Fontaine Rougeline, source qui l’hiver a toujours été probablement moins gelée, sans doute un peu ferrugineuse ou argileuse, rouge, par rapport au terroir, une fonte-haine, plus pure et moins souillée, que les eaux stagnantes de ces marais de ces méandres de l’Arnon. La souillure des lavandières, puis le captage de ses eaux, ne permettent plus d’en voir les vertus ni l’aspect. La responsabilité de Chârost, le casque du guerrier, son équipement, sa brillance, son éclat, sa saine transparence, sont là, dans ses coquillages d’eaux douces, voire dans ses alevins, ses têtards, etc., ces muses, ou bien dans ses écrevisses, voire ses mouches domestiques, ses taons, ses guêpes, ses grosses mouches bleues à viande, etc., en cas de présence de bestiaux à cet abreuvoir qui, par son attrait, pouvait attirer trop de troupeaux, voire des nomades anthropophages africains ou des barbares invasifs tortionnaires orientaux, point d’eau saine, ceinte, sainte, qui pouvait, par bousculade, noyer ces bestiaux, ou tuer ces nomades et par(T)-à-sites déracinés par leurs faits guerriers, et ainsi polluer tout l’aval par leurs charognes, dans cette descente aux eaux ferrugineuses, sableuses et argileuses, cette résurgence des Enfers, au bout de ce dé-mont, démon par facilité. Dans Bourbonnais est évoqué, Bourbon, Boruo, Borveau, Bourboule, etc., partout présent en France, dieu gaulois des sources chaudes et des Enfers, des âmes perdues… mais aussi surnom du bourreau et du bourot, le petit canard… en ce “coin, coin, coin”… Plus que de la superstition, il s’agit d’un post-it, pour un compte pour adultes, pour un comte, ou un duc, voire un aqueduc, par noblesse, ou bien d’un conte pour enfant en attendant qu’il prenne ses responsabilités à ce propos autrement que par usurpation, vol, appropriation, via quelques accusations typiques des sectes orientales des prédateurs esclavagistes empoisonneurs de puits et de sources, car l’enfant, la première source chaude qu’il a pu rencontrer fut celle de la bouche, du sein ou des effluves de sa mère, en attendant de pouvoir éventuellement survivre (une fois sur deux, généralité, καθολικῶς, des statistiques démographiques, science annexe de l’Histoire), et, en apprenant la patience, passé 12 ans, en espérant pouvoir éventuellement comprendre et recevoir la parole salvatrice du Père, et de ses buées, de ses suées et autres vapeurs d’eau de ses trop rares paroles entre deux taches sur ces “Joues”, ces Jo-Jo, ces sommets agricoles, sa cime cognitive et pluri-sémantique de singularité plurielle et de pluriel singulier.
C’est pas jojo… pourtant ce fut, paraît-il, un nymphée romain…
…