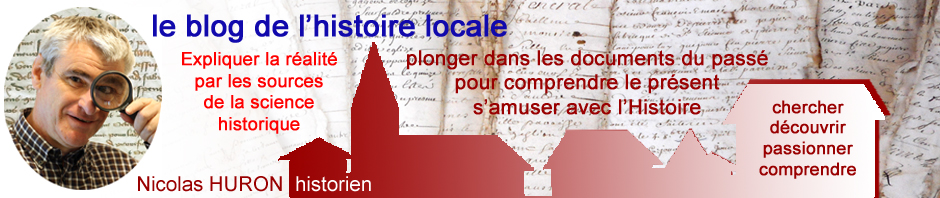Lien d’avertissements et d’enquêtes un peu entamées…
?
Xi rille…
Qui rit Leu…
qui rit île, ill…
Scie rit ?
avec Cyrille et Méthode…
Et, à la fin, vous serez un peu surpris… zzz…
en y cherchant les incohérences chronologiques… ou pas !
car c’est la veille de la saint Claude à cause du froid et du verglas…
mais je crois que sans tête, on tombe obligatoirement et cela se voit là…
Pour le 14 février, fête de la Saint-Valentin,
en carbonate de calcium et mer d’ammonites de la fin du Jurassique
toute en sain(T) val en thym, et en sein(g)s valant teint…
et en romarin, voire en Rome à reins par rôt marin…
faisons un peu la publicité du seul village français
portant le nom du patron des amoureux :
Saint-Valentin
dans le département de l’Indre
dans un ancien monde de reptiles marins
en Champagne berrichonne sur un tapis de symbole de Jupiter,
pour en rappeler en rappe Laie l’Empire en syn Valens et Valentinien 1er,
faisant après Jovien, Julien, Constance II et Constantin Ier, en chrétiens…
la colle entre l’Empire romain d’Orient et celui d’Occident alors confrontés
aux barbares pour en faire enfer ici symbole gréco-romano catholique.
Visitons l’histoire de l’architecture
du monument ECCLESIA
ayant donné son nom au village des amoureux…
avec mon ancienne étude et ses compléments étonnants…

église Saint-Valentin de Saint-Valentin (Indre) XIIe-XIIIe-XIXe siècles
L’église Saint-Valentin de Saint-Valentin (Indre)
XIIe-XIIIe-XIXe siècles
photo Nicolas Huron
…
Nicolas Huron : L’église Saint-Valentin de Saint-Valentin (Indre) – Dossier ECCLESIA août 1993, ouvrage de la conférence du samedi 28 août 1993 – Université François Rabelais – Tours –ASDRA – ASsociation pour le Développement de la Recherche Appliquée à l’animation culturelle en Région Centre – sous la direction de Bernard CHEVALIER, professeur d’histoire médiévale – Droits rachetés par Nicolas Huron, responsable et créateur du projet ECCLESIA pour l’ASDRA.
Ouvrage associatif aux droits acquis par son auteur,
relu et corrigé bénévolement, la veille de sa conférence datée du samedi 28 août 1993,
par ma mère, Marie-Claude HURON, née DEPUSSAY à Françay (Loir-et-Cher),
sa maison d’édition véritable, blésoise,
en sa bonne ville royale et agricole de Blois,
à une époque où son auteur, moi-même,
était encore illettré et dysorthographique.
Cliquez sous la couverture
pour consulter et/ou télécharger le fichier pdf de
mon ancienne étude-inventaire de son histoire architecturale en 40 pages :

à travers les siècles.
Lien transparent : https://patrimoine-rural.com/Saint-Valentin(36)Eglise.pdf
Ouvrage de 1993 à réactualiser
avec mon Poli poly-pôle ECCLESIA +
avec des exemples en « boutique » à votre service
comme par exemple avec l’église Saint-Louis de Précy (18),
et quelques compléments de recherches et quelques précis ions+- si dessous.
à partager avec cette carteNETpostale découverte
avec ses compléments étonnants…
ci-dessous
…

Continuer la lecture →