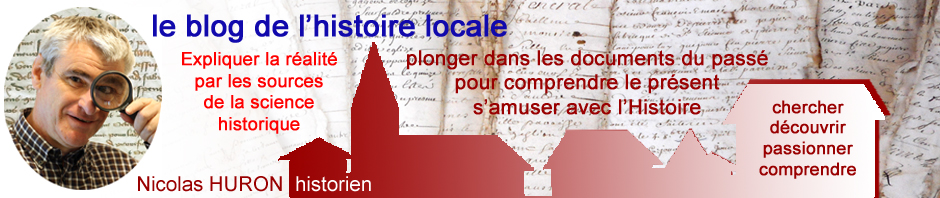Lien d’avertissements et d’enquêtes un peu entamées…
Nous savons que la plupart des noms de lieux précède la Révolution française dans leur forme phonétique dont l’étude est bien plus importante que l’orthographe.
C’est généralement le cadastre napoléonien, dit ancien, qui fixa l’orthographe des noms de lieux. La Poste et les Ponts-et-Chaussées en modifièrent quelques-uns, mais peu.
…
Connaître le danger et son ennemi…
Les habitants, pour savoir si quelqu’un est du cru, change parfois la prononciation, afin de pouvoir identifier un étranger.
Exemple : Artannes-sur-Thouet, s’écrit ainsi, mais se prononce Artannes-sur-Touette.
Cela fait un peu penser à l’anglais “mouillé, humide”, too wet, non ?
Coopération avec les colonnes infernales de la République p(h)arisienne ?
Ce n’est pas une question !
Un habitant peut donc savoir, si un visiteur le sait ou non, simplement à la prononciation du lieu. L’a-t-il lu sur une carte de la République française, de l’Etat ? S’est-il renseigné ? A-t-il de la famille dans le coin ? etc.
Oh, haut, eaux…

…
En tant qu’historien de milieu rural, quand j’ai commencé, mon étude d’Artannes-sur-Thouet, personne ne m’a dit que je me trompai dans la prononciation. Mais, je vérifie toujours avec un ancien du Cru qui peut, s’il le souhaite (sou wet), ne pas tout me dire, ou me tromper.
…
Autrefois aussi !
Il apparaît à l’étude des chartes anciennes des archives départementales, datant souvent des XIIe et XIIIe siècles, que la prononciation actuelle était déjà la même et que l’écrit n’a été généralement au milieu du Moyen Age qu’une adaptation latine.
L’adaptation latine par des clercs de la seconde moitié du Moyen Age nous montre une évolution qui va de tentatives de traductions latines, au XIIe siècle, vers une transcription phonétique du toponyme avec simplement un rajout d’une terminaison latine au XIIIe siècle.
L’ancien français apparaît dans les textes des clercs de l’Eglise catholique romaine vers la seconde moitié du XIIIe siècle, avec notamment l’apparition des officiaux.
Avant, pour la période précédant l’an mil, c’est plus complexe, car mâtiné de germains.
…
Un phrasé faune-éthique… incompris
Un toponyme est, le plus souvent, un phrasé phonétique en rapport avec son lieu, son histoire et sa géographie. Ainsi, chacun peut l’entendre à sa manière, mais en fonction des individus ou des besoins, il peut prendre un sens différent, voire plusieurs sens, mais une personne ou une communauté ne réussissent à en garder généralement qu’un seul.
Un étranger, un barbare germain par exemple, s’il y comprend quelque chose, entendra un phrasé toponymique différemment d’un habitant rural local car il l’entendra selon sa propre langue maternelle, voire selon son instinct propre, c’est-à-dire selon ses chromosomes.
Ainsi, pourquoi écrire Bourg (« forteresse » en gaulois, en romain, en germain, en républicain…) avec un « g » alors que celui-ci ne se prononce pas ? Obsession ? Question de Bourges ? Boure joua ?
Le b’ouh, ouh, RRRrrr ! ou simplement pour éviter la répétition : le Boure !
Sein ainsi RRRrrr en Boure ? Qui le comprend ainsi ?
L’Histoire nous montre que la République française, issue de Paris, ville germanique, même avant Clovis, n’entend et ne comprend rien à notre toponymie. Elle en perçoit les sons, réussit parfois à en enregistrer une forme, mais n’y comprend rien.
Et pourtant, elle pousse, elle pousse…
Ainsi la toponymie a été et est, encore actuellement dans le monde éditorial, victime de la mode des dictionnaires allemands des noms de personnes latines et germaniques des années 60, les Gaulois écrivant en grec, et les paysans esclaves insultés d’illettrisme (exterminés ici) n’ayant laissé aucune trace écrite.
Ce las peut se comprendre… questions de goûts…
…
Un cumul très ancien parfois remplacé par génocide…
Cependant chaque toponyme a un Sens (capital des Senons, synonyme de séniors, anciens, peuples qui ont installé les Parisii germains pour s’en défendre d’autres), dans le sens d’une singularité plurielle ou d’un pluriel singulier. L’interprétation du phrasé d’un nom de lieu, d’un toponyme, sa phonétique peut être ainsi faune-éthique. Et, il en est ainsi de toute la langue française qui est vivante.
Sans ce… Sang se… Sens ce…
Un phrasé compris par une oreille avec certains gênes venus d’ailleurs essaiera généralement d’imposer un sens négatif à ce que dit un habitant local pour pouvoir l’agresser, voire s’il est occupant du pays, pour pouvoir le ruiner ou le tuer, via une justice à sa solde.
Cela fonctionne aussi pour le langage vestimentaire, gestuel, corporel, odoriférant, etc. et les scientifiques savent que la gente féminine ne prend que peu en compte le contenu cognitif ou sémantique d’un message, mais à 70 % son ton, la politesse, la marque des chaussures du locuteur… bref la God ace…
Plus une personne ne sait rien faire, ou pas grand chose, ou plus elle est étrangère au monde qu’elle visite, plus elle sera agressive en la matière, ou toute en charme et sortilèges, sauf si elle sait qu’elle n’y est que passagère.
Cet handicap agressif ou charmeur peut aller jusqu’à détruire le monde, la nature, et jusqu’à ce qu’un “réfugié” saxon barbare sorti de l’actuelle Allemagne au VIe siècle, se prenne pour un Britton et transmette cette maladie, cette usurpation, ce vol, à un Breton par sa descendance, à l’encontre d’un Armoricain, par exemple, après trois ou quatre sauts de moutons…
Nous connaissons en Histoire médiévale, entre le VIe siècle et la Renaissance, l’agressivité des bandits “Bretons”, presque toujours alliés aux Anglais, leur “expulseurs”, pour ce faire.
On croise parfois quelques curiosités historiques… quelques constantes…
…
C’est bon pour Le Moral (Egliseneuve-près-Bilhom, 63)
La toponymie apparaît ainsi comme une science de contrôle d’état de la science.
bis repetita
La toponymie apparaît ainsi comme une science de contrôle d’Etat de la science.
ter
La toponymie apparaît ainsi comme une science de contre rôle des tas de la science.
Un phrasé toponymique, même court, n’a ainsi pas un seul sens, mais porte aussi l’identité, dans le temps et dans l’espace des cultures des usurpateurs des lieux.
Joueur et jouisseur, voulez-vous habiter à “Par ris”, “paris”, “Lyon”, “lions”, ou bien Parmoin (commune de Sagy, 71, Saône-et-Loire) ?
C’est bon pour le moral… le mot râle…
Cet otto-ma-tique… C’est haut taux maths-tiques, c’est Toto ma tique ! Cette auto ?
…
Un entrecroisement vivant spatio-temporel…
Un toponyme, phrasé toponymique, est un entrecroisement poussant dans le temps et dans l’espace, mais restant généralement phonétiquement plutôt intact. Il est et reste vivant, car agissant sur autrui et vice versa. C’est un cumul étagé sachant que, d’une certaine manière et proportion, qui se ressemblent s’assemblent.
Noms de Dieu, il est part du Verbe.
La linéarité du phrasé toponymique pouvant faire l’objet de superpositions, comme des Plessis, montre parfois une absence de limites connues puisque, la langue évoluant, la compréhension initiale se perd.
Ainsi qui peut penser aujourd’hui :
– Saint-Cyr-du-Gault (41, Loir-et-Cher) ou Seings cire dû Goth ?
Gault, la rivière, gault, le bois, Goth, le barbare, gaud, mendiant,
got, trou en terre spécialement pour planter la vigne,
Got, dieu germain, GO, l’ordre, d’Hugo (seigneur d’Amboise), etc.
Seins s’ins-ire du GO haut ou sain sire du gu’eaux ?
Cela monte ou cela descend ?
Les deux mon capitaine…
…
L’exemple de Saint-Cyr-en-Bourg (49, Maine-et-Loire)
Ayant déjà beaucoup dégrossi l’étude de ce toponyme, je me suis aperçu qu’il évoquait en matière d’environnement, de géologie, de géomorphologie, de géographie et d’Histoire, un grand nombre d’évocations : un promontoire isolé, des aigrettes, Sirius, l’autorité, le Christ, une succession de forteresses gauloises, romaines, franques, la christianisation, la lutte contre l’esclavage, la veuve et l’orphelin, voire même un terroir plus vaste, un panorama sur un aboutissement de rivière pouvant même remonter son cours, l’évocation de la mère d’un dieu gaulois, ou simplement un nom possible de dolmen ou de grottes troglodytes anciennes, etc.
Saint-Cyr-en-Bourg n’a pas qu’un seul sens, mais une multitude. Il est une vérité du lieu. Cependant, il faudrait parler d’une parcelle de Vérité, considérée comme une singularité plurielle ou un pluriel singulier, l’étranger, comme pluriel lui-même, y ayant mis souvent étrangement sa propre compréhension.
Quand on baragouine…
Artannes-sur-Thouet, commune voisine, évoque ainsi un resserrement du relief, des tanneries, des ours et des saumons, une ânerie gallo-romaine, une référence biblique, etc.
On doit parler de graine sémantique vivante du Vivant…
Ainsi Saint-Cyr-en-Bourg peut être vu comme un cumul d’éléments de sens divers, qui fonctionnent quasiment tous avec le lieu baptisé ainsi, ayant passé moi-même des mois à les vérifier :
– Saint-Cyr-en-Bourg (culte de saint Cyr, assassiné, à la tête éclatée sur du calcaire de construction, et sainte Julitte, travaillée et assassinée), d’où :
– la présence d’une ancienne justice inique rackettrice romaine ou germanique, voire actuelle selon la loi des constances,
– une nasse pour trouver ceux qui contesteraient cette justice inique tortionnaire, ignare, cruelle,
– une invitation à une libération chrétienne ou à une révolte, ou à une soumission au profit,
– la provocation d’une allergie, soit à la nature, soit à son exploitation, par exemple celle du paysage naturel totalement remplacé et industrialisé, au point d’en montrer la roche, le sol au soleil, les marches et les falaises ou les murs en calcaires sur lesquels cette nature fut précipitée comme la tête du petit saint Cyr.
– Seins s’y rembourrent, pour quelques compléments alimentaires anciens, voire plus…
– Seings cire en Bourg, pour les sceaux de l’autorité militaire de cette ancienne énorme forteresse de frontières antiques, et le reste…
– S’ins s’y r’ambe bourre, à propos de la rivière, ambe, de Loire qui peut remonter devant ce bourg, sur celle du Thouet… tout mouillé ! To wet !
– S’ins s’y r’ambe boure, à propos des canes, mères des bourots, petits canetons, et Bourot synonyme du dieu des eaux profondes et bouillonnantes, et le reste…
– Sain Cire (aigrette) rend bourre, à propos des plumards aux plumes blanches… voire même des colombes de la Vénus trouvée dans le cimetière du lieu, mise au musée de Saumur, et passée je ne sais où…
– Ceint cire rend bourg, à propos de la protection de la cire des abeilles, et de la lumière des chandelles et des cierges, là en Anjou troglodyte, et du reste…
– Saint-Cyr en Boure, synonyme de bure, l’habit monastique des défricheurs et gestionnaires du terroir au Moyen Age et du reste… tous ces hommes valeureux décédés sans descendances que la République mange encore, et encore…
– S’ins si re… en bourg, synonyme médiéval de bâtard, de truand… se référant notamment au bourgage, droit de bourgeoisie, ou aux paris des tavernes où on se bourre la gueule…
– Saint-Cyr rend boure, synonyme de bure, la clé… peut-être l’une de saint Pierre, l’autre étant au prieuré Saint-Pierre d’Artannes, en face, sur l’autre rive, éloigné, trahissant devant le crime s’accomplissant…
– etc., en fonction des circonstances et des époques…
Car, par exemple, qui décida et à quelle époque que « bour », écrit « bourg » mais pouvant s’orthographier « boure » ou autrement, est masculin ? Il peut être toponymiquement féminin en la circonstance… ou autre.
Hein ? ça se tape la bourre ?
Et, qui décida d’accrocher ambe, la rivière, au son « hourds » pouvant s’écrire « Ur » ou « ur », et pouvant se référer également à l’auroch, uros gaulois, urus latin, ur norique, bovidé des noues et autres zones humides ? Sain Sire ambe Ur prenant ainsi un sens se rapportant à la présence d’un seigneur taureau, éventuellement ceint, avant d’être saigneur.
Olé ! Eau lait ! Haut Lée…
Tout eu nœud culte Ur !
Tout tu (verbe taire), nœud culte Ur ! de boucherie… et d’art tannerie.
On entendrait presque les grenouilles,
sous les pieds des bovidés, avant le gosier de l’aigrette :
S’ins IRE ambe ouRRRRrrrrr !
Presque l’Apollon gaulois… Bouro, presque Bour-bon !
Presque Louis XVI… le bon Père.
…
Essayez avec :
– Saint-Cyr-sur-Braye (41), à propos des cris, des pantalons, de toiles cirées ou des ânes de ce carrefour et ancienne vile gallo-romaine ?
– Saint-Cyr-sur-Loire (37), sur loup art, sûr l’hoir ?
– Saint-Cyr-la-Lande (86, Vienne).
– Saint-Cyr-en-Val (45, Loiret).
Le problème est que, pour bien creuser, il faut de l’expérience et être instrumenté et que cela ne s’improvise pas, quoique… avec quelques bons dictionnaires…
Mais la vraie question est : Est-ce génétique ou culturel, ou bien les deux ?
…
Un parti pris instinctif et donc génétique…
Vous lisez ? Saint Paul, apôtre du Christ, a dit que la lettre, comme singularité plurielle, tue l’Esprit comme pluriel singulier.
Que lisez-vous ?
“Le temps a laissé son manteau,
De vent, de froidure et de pluie,
Et s’est vêtu de broderies,
De soleil luisant clair et beau”
Charles d’Orléans
prisonnier à la bataille d’Azincourt
et enfermé, engueulé par les Anglais,
dans la Tour de Londres
bâtie par des Normands.
Que lisez-vous ?
Et qu’entendez-vous à l’oreille dans le sens de “comprendre” ?
Deux soleils luisants, que l’air est bot ?
Claie erré beau ? Que l’Erebo ?
Qui entend ? Qui con prend ? Parti pris ou passeport ?
Reconnaissance génétique ?
Râle en tir(e)… ou pâles en tirent…
L’Enfer est pavé de bonnes intentions…
deux bonnes, Huns tant scions ?
(deub aulne, pour les médiévistes…)
des uns tension (+ ou –) en fer bien calé ?
Lent faire ?
zzzzzzzzzzzz intense si ions ?
intenses scions ?
Elle est bonne ?
…