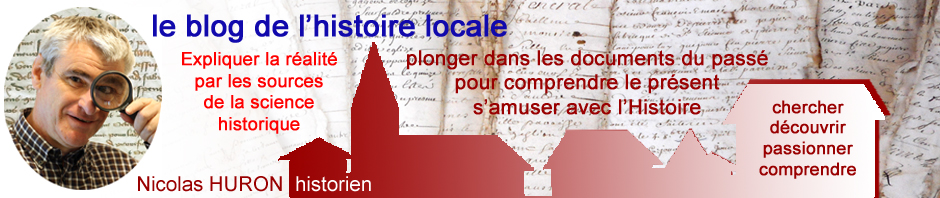Lien d’avertissements et d’enquêtes un peu entamées…
Questionnements de sens cumulés successifs infinis ici un peu définis
La preuve de la spiritualité phonétique
dysorthographique médiévale !!!
Feue faite et absolue cas(E) d’eaux apocalyptiques
Un sein nid colla un cas d’eaux pour… des mottes et…
en mare y a jeux… un peu ferrugineux… plus bas…
Plongée dans l’infinie poésie
des noms de nos lieux…
La taupe honnie mit le top aune y mit… la toponymie.
Cadeaux de bonnes us et c… à déballer lentement, judicieusement
L’église Saint-Nicolas de Saint-Nicolas-des-Motets (37)
sur la route entre Blois et Château-Renault… entre l’Orléanais et l’Ouest…
lieu-dit routier évocateur au sud-est des mines de fer de l’ancien pays des Carnutes.
Le Père Noël, patron des bouchers, des boulangers, des marchands, des étudiants, etc.,
sur la route parallèle au Chemin des Poulains parmi les élevages de la Gâtine tourangelle
entre le grenier à sel d’Herbault et les tanneries de Château-Renault
sans doute pour compenser Saunay (nés dans le sel ?),
souvenirs éternels de la légende des trois petits enfants
qui allaient glaner aux champs… et des autres !
Photo Nicolas Huron
+++
Trophée romain
Trop fée
Trot fait
Pour les toponymes Saint-… ancien, voir Saint-Plantaire !
Illustrer l’ouïe, vos yeux et mate air
de nos panneaux routiers
et de nos cartes…
L’ARMES !
SP…
V
Au regard des cartes et inventaires partiels ci-joints, nous posons ci-dessous ces questions d’historien que personne ne se posent. Faites donc ici comme des enfants auprès du sapin de Noël. Ouvrez vos cadeaux sans savoir vraiment ce que vous y trouverez et sans vraiment savoir qui les a déposés ici-bas.
Pour mieux réussir, il faut ouvrir et consulter mes cartes avec cet article et y sortir, dans d’autres fenêtres, les cartes des Saint-Nicolas de France et de la Région Centre, comme cet exemple :
Saint-Nicolas-des-Motets ? Saint-Nicolas d’émotté ? Dême ôtée ? D’aime hautée ?
Des motets ? Les mottés ? Lée motté (dolmen) ? Lays mottées en fonderies ?
L’aime au T’es ? Les mots T ? Laid m’hottait ? L’aime hôtée ? Etc.
Prenez un cahier et un crayon de pas pillé et changez…
Et vos yeux s’illumineront…
d’orthographes !
Pour la culture, Général !
…