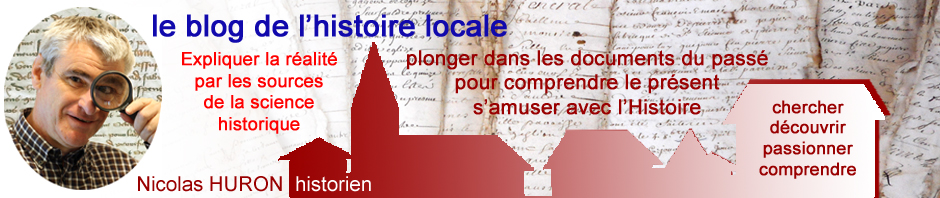Lien d’avertissements et d’enquêtes un peu entamées…
L’église Saint-Georges de Saint-Georges-sur-Arnon (36, Indre, ancien diocèse de Bourges) a beaucoup plus de connaissances à vous apprendre que vous ne pouvez l’imaginer…
Un trésor de révélation, de richesses et de savoir-faire…
Carte-partage-découverte !
Clic gauche sur l’image puis clic droit dans la fenêtre
et enregistrer l’image sous… et oser le partage !

Carte-decouverte-Saint-Georges-sur-Arnon
L’église Saint-Georges de Saint-Georges-sur-Arnon (36)
Une enquête historique et géographique,
architecturale et humaine pleine d’instructions
et pleins de cadeaux à télécharger…
Carte-découverte à partager !
…
Début d’une réactualisation scientifique ci-dessous
puis ancienne brochure téléchargeable.
Première mention écrite médiévale devant une explication antique
La première mention écrite de Saint-Georges-sur-Arnon à travers la mention de son église, ecclesia Sancti Georgii, figure dans une bulle du pape Adrien IV datant de 1154 et copiée dans le cartulaire d’Issoudun, acte pontifical étant la première mention écrite d’une bonne vingtaine de communes du secteur et acte papal sur lequel je ferai sans doute un article prochainement (il suffit de me le demander).
Tous les chemins mènent à Rome, RRRRrrr’Homme !
Cette première mention écrite est une traduction latine médiévale et l’on disait déjà Saint-Georges, voire Saint-Georges-sur-Arnon, toponyme complet mentionné sous cette forme dès 1518, voire même avant la Révolution française, en 1788 (voir dans mon étude à télécharger ci-dessous).
On associe donc le toponyme Saint-Georges au culte du Grand Martyr grec.
Peut-on aller plus loin ? Peut-on remonter à l’Antiquité romaine ?
…
Un fait géomorphologique étonnant
Il y a une réalité géomorphologique étonnante que j’ai découvert en étudiant le toponyme de la commune voisine de Chârost. Les deux méandres de la rivière de l’Arnon avec un peu l’amont de Chârost, ressemblent, pour qui sait à quoi cela ressemble, par leur relief à un hippocampe, hippocampus en latin (ce qui pour un Romain se comprend comme « camp du cheval »), ἱππο·κάμπιος en grec construit avec la racine κάμπτω, camptô, champto, courbe, méandre.
Vérité éternelle connu des Grecs…
Qui se ressemblent, s’assemblent !
Loi, à la mode actuellement, de l’attraction ?
…
Une trace de renfort de protection des grands édifices aristocratiques gallo-romains…
Saint-Georges-sur-Arnon trouve sa raison d’être antique par sa situation de renfort de cavalerie situé à 8 à 10 kilomètres de Saint-Ambroix (18, Cher, ancien diocèse de Bourges) qui était un très important site gallo-romain sur la voie romaine de la Chaussée de César.
Saint-Ambroix (mon étude sur son église) était en effet, à l’époque romaine, un vicus, site religieux et administratif, mais surtout marchand, autrefois nommé Ernodurum ou Arnodurum, toponyme mentionné sur des documents antiques, et signifiant en langue gauloise : la place, le marché de l’Arnon. Ce site comportait basilique, nécropole, sanctuaires, autels sacrificiels, villae aristocratiques importantes, etc. Nombre de stèles funéraires trouvées à Saint-Ambroix et bien d’autres découvertes sont visibles au Musée archéologique de Bourges, musée appuyé sur l’ancien rempart gallo-romain, ancien palais Jacques Coeur, redresseur de l’économie française au XVe siècle.
Saint-Georges-sur-Arnon est aussi lié à l’église, dédiée au grand légionnaire romain saint Martin, de Poisieux (18, Cher), toponyme très rare, lié à la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, et lié forcément à Saint-Georges-de-Poisieux (18, Cher, ancien diocèse de Bourges) situé près des ruines gallo-romaines de Drevant près de Saint-Amand-Montrond (18, Cher), et lié à Saint-Amand-Longpré (41, Loir-et-Cher, ancien diocèse de Chartres), situé près de l’église Saint-Georges de Gombergean, etc.
Poisieux ? Les sous sous les as ? Les étoiles dans les yeux ?
Ce rapport entre les grands passages du pillage racketteur romain et les grands sites gallo-romains de la dictature païenne esclavagiste de l’empire romain, est le cas de presque toutes les églises Saint-Georges en Région Centre.
Cette curiosité historique est confirmée par ma grande étude sur les toponymes Saint-Georges de la Région Centre dont vous pouvez lire les extraits copieux dans les articles précédents.
On peut étendre l’étude à la France entière… mais à Saint-Georges-sur-Arnon, en plus, symboliquement, saint Georges terrasse le dragon, le serpent, les méandres de l’Arnon, assez rares sur le cours de cette rivière et les derniers avant Vierzon. Dans les méandres se cumulent quelques pourritures et empestations un peu hallucinatoires. Saint-Georges-sur-Arnon semble être destiné à en maîtriser les mouvements et Folies (cumul de feuilles produisant des gaz… situé dans des dépressions du relief, souvent dans des vallées), après Chârost, Saugy, Saint-Ambroix…, qui devaient être sans doute piquées et à torcher parfois.
Voir mes cartes avec mon article d’inventaire : les cartes, la liste et les liens…
Cartes téléchargeables et liens à construire avec vous…
…

Continuer la lecture →