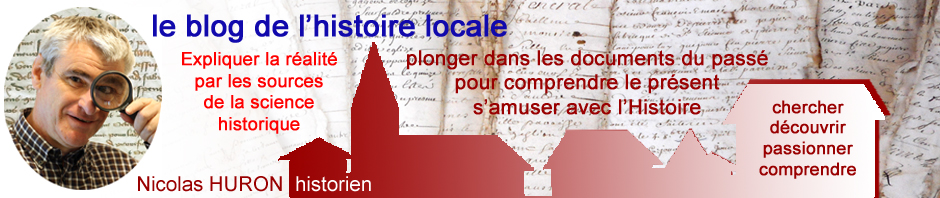Lien d’avertissements et d’enquêtes un peu entamées…
Saint-Cyr-en-Bourg est un ancien phrasé, resté caché et secret pendant des siècles…
L’actuelle entrée du bourg de Saint-Cyr-en-Bourg,
avant de vous en faire découvrir
présentement une autre…
Photo Nicolas Huron
…
Une histoire de langues bien gourmandes…
Sous les Romains, puis sous leur Empire, puis sous son héritière, l’Eglise catholique romaine, ces administrations étrangères écrivaient ici latin, jusqu’au milieu du XIIIe siècle. On sait qu’on y parlait déjà à cette époque-là le français… L’ancien français ?
Avant eux, les Gaulois, gale germanique celte, voire plus orientale en corps, écrivaient uniquement pour la comptabilité et surtout en têtes coupées et rires homériques conservés dans des « hauts pis d’hommes » (qu’on peut écrire oppidum) et des bocaux (qu’on peut écrire « beaux caux », dans le genre de Saint-Cyr-en-Bourg)…
Malgré tout, autrefois, on était intelligent, on écrivait suffisamment grec pour savoir qu’écrire tue l’Esprit et ne sert pas à grand chose, sinon aux imbéciles qui veulent vous imposer un sens unique inique à la Vie et au Vivant. Maintenant, on peut…, enfin moi habitant local, descendant d’esclaves depuis des millénaires, descendant de votre esclavagisme (à moins que vous ne payiez cette consultation) je peux vous le dire…
C’est un peu comme un certain chandelier de style perse, donc romain,
volé et retrouvé dans un certain temple de brigands…
Caverne d’Ali Baba ou Grotte de Lascaux ?
”Les deux, mon capitaine…”
Ses âmes, ouvre-toi !
Mis à : « Meuh ! » ?
Mi-âmes ?
Miam !
…
Une administration ignare, criminelle, cruelle et régicide
Espace vital allemand, germanique et anglo-saxon obligeant, avec la Révolution française, cette même administration étrangère, par soucis génocidaire et destruction planétaire rentable ou commissionnée, n’y comprit évidemment guère plus, voire guerres plus, pour ne pas dire rien, Paris et ses Paris-Goths, étant une implantation germanique, d’abord posée par les anciens Gaulois sénons pour se protéger des Germains belges, puis par le Franc Clovis pour se protéger des Germains germains de « Guerre-manie », nommée pudiquement actuellement Allemagne, et notamment de leurs Angles, Saxons, et autres barbares abominables, etc.
N’oublions bien sûr pas l’intermède romain de Lutèce : lutte est-ce ?
T’es rat pi ? Des vil(l)es ? Oui, oui ! Si, si… RRRrrr…
Grammes m’errent ou grammaire ?
Faune éthique ou phonétique ?
Gênes au Cid ou… ?
Hors ou or ?
Clos vice ?
Finement
con…
…
La grande découverte toponymique du millénaire, voire plus
Par mon sang, pour retomber sur mes pieds et mes pillés d’ancêtres (à orthographier…), après une longue étude de vérification sur le terrain et par la cartographie, j’ai découvert que Saint-Cyr-en-Bourg était, évidemment en rapport avec un ancien bourg gaulois (germain celte), puis romain (turque troyen), une forte et grande forteresse de frontière avec, évidemment, la présence ancienne d’une justice inique, cruelle, débauchée et cynique, tueuse d’enfants et violeuse de jeunes femmes, y ayant implanté pendant la christianisation et ses tentatives de mise à bas de l’esclavagisme, le culte de Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, mais j’y ai découvert aussi que les toponymes Saint-Cyr, dont celui de Saint-Cyr-en-Bourg, qui fait l’objet de mon étude pour sa municipalité, était en rapport avec la racine latine ciris, l’aigrette, l’oiseau échassier blanc des zones humides (voir les articles antérieurs de cette étude “vis ta mine” : Saint-Cyr), lui aussi transformé en vain.
Une porte s’est ainsi ouverte sur une réalité environnementale… détruite des truites.
Sain Sire ambe Our !
Hambourg ?
Nein ?!
…