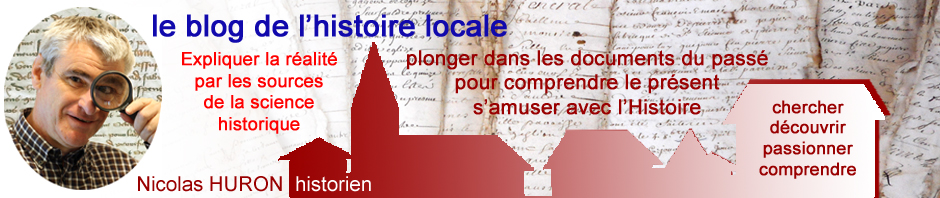Lien d’avertissements et d’enquêtes un peu entamées…
Tous ensemble ?
Faire religion, c’est étymologiquement « relire, réobserver » et non relier.
Relire ou relier les Saint-… chrétiens catholiques romains ?
Suite à une demande par courriel d’un membre du Centre d’Estudis de Montornès del Vallès, dans la province de Barcelone, en Espagne, à propos des inventaires des églises consacrées à Saint-Saturnin, pour leur Església de Sant Sadurní de Montornès del Vallès, connue en 1162 et désignée comme capella del Santíssim de Montornès, en 1302, je me suis aperçu qu’il fallait que j’explique comment je procédais pour faire moi-même ce genre d’inventaire.
Une courbe de la Creuse vue de Saint-Saturnin de Ceaulmont (36)
comme à Montornès del Vallès…
en plus impressionnant.
Cerise sur le gâteau !
…
Donc, partons ici en explications bibliographiques
sachant que les bibliothèques publiques sont une invention de Jules César, J. C.,
et donc surtout du dieu Auguste César, le dieu de l’enfance heureuse et studieuse
de Jésus Christ, Notre Sauveur et Notre-Seigneur, J. C., qui en dispersa les principes,
y compris dans mes classes de maître d’école du Cher, du Loiret, du Loir-et-Cher,
et présentement, comme vous pouvez le constater, sur toute la planète.
Quand un lieu, généralement identifiable par un édifice, église, chapelle, statue, fontaine, etc., a été, et parfois est encore, consacré à un culte chrétien catholique romain, nous parlons de dédicace, de patronage ou de vocable. Il s’agit généralement d’une fondation ou refondation finalisée par une consécration.
…
…
Ainsi beaucoup d’églises, réputées fondées à telle date, ont été dans la réalité des re-consécrations après une période de guerre, de destruction, d’abandon, ou de reconstruction pour rénovation ou pour correspondre à un changement de mode architectural(e), par exemple lors du passage de l’architecture préromane, souvent en bois, à l’architecture romane en pierres, vers la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle, ou sous la révolution industrielle sous Napoléon III, voire pendant la 3ème république, où beaucoup d’édifices médiévaux ont été démolis et remplacés par des édifices dont les plans avaient été établis par les architectes départementaux, généralement plutôt ignares et francs-maçons… à en croire une vraie église romane ou gothique et leurs faux styles industriels néo-romans ou néo-gothiques.
Quand j’ai commencé mes enquêtes en Région Centre sur les églises présentant des traces d’architecture médiévale en 1988, pour mon premier ouvrage et ma première conférence-spectacle en 1989 à Bueil-en-Touraine (37 ; Indre-et-Loire), j’ai constaté, lors de mes recherches, qu’il était difficile, voire impossible, d’établir un inventaire des lieux consacrés à un culte particulier. Ma recherche portait alors sur les églises Saint-Pierre, les églises Notre-Dame et les églises Saint-Michel, Bueil-en-Touraine ayant cette particularité d’avoir un édifice abritant deux lieux de culte : sa très ancienne église paroissiale Saint-Pierre et sa collégiale seigneuriale fondée en 1394 et consacrée à la Vierge Marie, à saint Michel et aux saints Innocents (voir mon étude d’inventaire à son sujet).
En 1988, alors qu’il n’y avait pas encore le Web où tout le monde peut profiter, le plus souvent indument, des informations recueillies par quelques bonnes volontés, faire la cartographie de l’implantation des églises Saint-Pierre fut assez long et complexe, sachant que, comme encore aujourd’hui, il n’existait que très peu d’ouvrages imprimés d’inventaire portant sur les édifices, existants ou disparus, de culte chrétien catholique romain.
Certains peuples, connus pour cela, attendent parfois longtemps
d’avoir le moyen d’obtenir tout gratuitement et sans effort…
Croyez-en les coccinelles mexicaines !
ou la récente entrée dans l’Âge du Fer de la Chine…
De plus, la recherche est rendue d’autant plus difficile, que les églises ne sont pas cartographiées comme des toponymes, des noms de lieux, sauf si elles ont baptisé une rue, une place… C’est vérifiable à Bueil-en-Touraine, alors que le toponyme Saint-Pierre de l’église de Bueil a pu, autrefois, être un toponyme Sympierres, désignation d’un édifice antérieur, ou plus vraisemblablement d’un témoignage de mégalithes disparus, comme je le soupçonne au sein des études récentes que j’ai faites à Artannes-sur-Thouet et à Saint-Cyr-en-Bourg, en Maine-et-Loire (49), avec l’église du prieuré Saint-Pierre d’Artannes qui semble bien un toponyme préhistorique Sympierres indiquant la présence d’anciens prés sacrés de vaches sacrées, un ensemble attesté d’anciens mégalithes, un sol pierreux non inondable devant une plaine sableuse inondable, mais aussi un panorama sur un coteau calcaire.
Dolmen de la Pierre Couverte à Bagneux, près de Saumur (49),
monument comparable au dolmen ayant servi à construire
les ponts mégalithiques d’Artannes-sur-Thouet (49)
techniquement et linguistiquement un Sympierres
Photo Wikipedia
…
L’église Saint-Pierre du prieuré d’Artannes-sur-Thouet
située non loin d’un grand dolmen démoli,
un Sympierres de mégalithes
Photo Nicolas Huron
…
Comme, en plus, il s’agit d’un char blindé d’art roman, on peut considérer cela
comme une initiative véritablement très chrétienne catholique romaine
aux temps des bombes atomiques judéo-islamo-athées…
et autres radioactivité en activités radio faunique
de signaler ce Sympierres et ses troglodytes.
Donc, en faisant un inventaire des lieux de culte consacrés à un saint chrétien catholique romain, à Notre-Dame, à la Madeleine, voire à l’Archange Saint-Michel, on a affaire, soit à un toponyme préhistorique, c’est-à-dire à une christianisation du phrasé préhistorique, comme à Saint-Cyr-en-Bourg (49), à Saint-Hippolyte-sur-Dive (49), paroisse disparue et voisine de la précédente, comme à Saint-Maurice-sur-Loir (28) sur Bonneval, à Saint-Maur (36) près de Châteauroux, à Saint-Plantaire (36) près de la Creuse, à Lourdoueix-Saint-Michel (36), à Saint-Michel-de-Volangis (18), à Saint-Michel à Paris (75), etc., et même à Sant Sadurní de Montornès del Vallès (Espagne) que j’ai géographiquement vérifié, soit à un toponyme gallo-romain, comme pour les Saint-Saturnin de Touraine (37 et 41), l’église Saint-Pantaléon de Saint-Plantaire (36) en Berry, Notre-Dame de Paris qui fut sans doute un remplacement d’un « notre dèmos » féminisée par sortilège, charme, galanterie et drague étrangère, la basilica di San Pietro in Vaticano, dont le nom devrait être Petrus à prononcer « pète rousse » à défaut de « pète rat » en Jordanie, etc., soit à des toponymes médiévaux ou modernes comme les églises Saint-Nicolas ou Saint-Louis de France, ou plus récents encore, d’époque contemporaine, comme l’église Saint-Bernard-de-la-Chapelle à Paris, où Louise Michel appela au massacre des gauchistes de l’époque.
Préhistorique ou Gallo-romain ? Les deux mon capitaine !
Syn-mi-shell de Paris et Saint-Michel de Bueil,
faut-il les mettre dans le même panier ?
Faut-il mettre ses « euh »… dans le même pas nié ?
…
Une curiosité statistique géographique
La syllabe « sin » prononcée sain, syn, ceint, saint, seing, seins, s’in-, voire même parfois prononcée « si nœud », syllabe que l’on trouve parfois dans le Sud prononcée sang, sans, s’en… ou « ça ne… » avec l’orthographe « san » (voire sant avec d’autres caractéristiques géographiques), syllabe qui est en rapport avec Seine, hydronyme méandreux, est extrêmement parlante en géomorphologie, car elle désigne la notion de courbure, de méandre par exemple, ou d’avancée rocheuse ayant cette forme. Elle est en rapport avec l’ancienne lettre grecque Sigma, le C, caractérisée par sa forme de croissant de Lune.
Exprimons, à ce propos, une bizarre sensation d’un chercheur expérimenté et découvreur comme moi, qu’il y a une étrangeté statistique dans les toponymes Saint- suivi d’un complément en France, c’est que les communes portant un nom commençant par la syllabe cein-, sain-, sein-, sim-, sin-, syn-, ne sont pas si nombreuses qu’on pourrait l’espérer en géographie : Ceintrey en Meurthe-et-Moselle (54) ; Sain-Bel dans le Rhône (69), Saincaize-Meauce dans la Nièvre (58), Sainghin-en-Weppes et Sainghin-en-Mélantois dans le Nord (59), Sainpuits dans l’Yonne (89) ; Seingbouse en Moselle (57) ; Simplé dans la Mayenne (53) qui se pense comme un Syn-Plaix, selon son paysage ; Sin-le-Noble dans le Nord (59), Sinceny dans l’Aisne (02), Sincey-lès-Rouvray dans la Côte-d’Or (21), Sindères dans les Landes (40), Singles dans le Puy-de-Dôme (08), Singrist dans le Bas-Rhin (67), Sinsat dans l’Ariège (09), Sinzos dans les Hautes-Pyrénées (65) ; Le Syndicat dans les Vosges (88).
Indiquons aussi, à contrario, que les communes commençant par Saint- suivi d’un complément sont légions et se comptent par milliers (94 pages dans mon dictionnaire des communes), en ajoutant que les communes commençant par Sainte- qui expriment une notion de pillage, de voleurs, de brigandage, ne sont pas très nombreuses (10 pages dans mon dictionnaire des communes). Cette particularité nous indique que la France est bien un pays chrétien catholique romain dans tous les sens des termes de cette expression consacrée.
…
Donc comment faire un tel inventaire ?
Il faut préciser, qu’un édifice comme une église paroissiale peut avoir plusieurs consécrations, et avoir été le lieu de plusieurs fondations, car une église, une abbaye, une cathédrale, etc., peuvent contenir plusieurs chapelles, dans le temps comme sur son espace d’enclos paroissial. Ainsi la Sainte-Chapelle sur l’Île de la Cité à Paris, était autrefois consacrée à saint Nicolas avant d’être reconstruite par Saint-Louis. Notre-Dame de Françay en Loir-et-Cher (41) était aussi consacrée à Notre-Dame de Pitié, à saint Jacques et à saint Sébastien, puis à saint Joseph, et ce n’est pas un cas particulier, c’est le cas de presque toutes les églises paroissiales. C’est donc un inventaire très complexe et forcément incomplet auquel il faut à chaque foi(s) s’attaquer.
Il faut donc d’abord reconnaître l’évidence qu’un inventaire complet historique et honnêtement géographique des lieux de culte consacrés à un saint chrétien catholique romain important et célèbre est illusoire. On peut s’approcher d’un inventaire complet pour une période donnée, notamment pour la seconde moitié du Moyen Age, pour l’Époque Moderne, ou pour l’Époque contemporaine. Mais il faut savoir que des toponymes non christianisés dans la moitié nord de la France et commençant par San-, comme Sancerre, Sancoins, Semblançay, Sambin, Santenay, etc., auraient pu être christianisés dans la partie sud du Royaume de France, où l’on fait traîner et résonner les syllabes (en montrant les dents…), en attirant à lui un saint catholique romain, comme je l’ai démontré avec Saint-Cyran dans le Sud du Berry.
Saint-Cyran-du-Jambot…
ou Syn-Cyr rends… ???
L’usurpation d’une usurpation d’un établissement religieux consacré…
Saint-Cyran-du-Jambot (36)
…
Un nichoir à aigrettes blanches…
À voir et à revoir sur Géoportail et sur le terrain…
Sainte mère ou mère enceinte ?
…
L’église Saint-Symphorien de Ciran (37)
devant une faille géologique…
avec ses gros parpaings romains antiques au pied de son chœur
…
À voir et à revoir sur Géoportail et sur le terrain…
Ceinte mer ou mère rend ceinte ?
…
Qui se ressemblent s’assemblent… avec les sites pour vérifier…
car le point de vue, historique et géographique, est donc très important…
car un toponyme ne désigne pas forcément un lieu, mais parfois aussi ce qu’on y voit,
car à Beauregard, à Bellevue, à Remiremont, on ne regarde pas que ses pieds et ses pillés…
et le Mont-Blanc, comme le Cervin, rouge sang au petit matin, se désignent de loin…
mais à Saint-Michel, autrefois Syn-mi-shell de Paris, quand la Bièvre y coulait…
cela se voyait dans l’eau de cette rivière remplacée par la Seine
pour en défendre d’un marais puant l’Île de la Cité,
comme à Ivry-sur-Seine…
Pour approcher l’inventaire recherché, il faut donc se constituer une ressource bibliographique spécialisée, les listes figurant sur le Web étant à l’heure actuelle le plus souvent incomplètes, mal documentées et mal référencées, et comportant souvent des erreurs. Donc si une liste du Web est utilisée, il faut la vérifier dans son entier, ce qui peut être assez long. Les ouvrages imprimés, anciens ou non, étant plus fiables car la responsabilité de l’éditeur et de l’auteur sont en jeu bien que ceux-ci peuvent être dans l’erreur, alors que sur le Web, c’est le plus souvent le grand n’importe quoi… et je ne plaisante pas.
Vous êtes sur le Web, là, non ? En anonyme ?
Ayant surtout expérimenté ce travail d’inventaire des vocables, patronages et dédicaces, sur la Région Centre, je peux indiquer comment s’y prendre, sachant que mon département, le Loir-et-Cher, est très particulier à ce propos, car très bien équipé. Il est donc bon d’avoir une approche départementale, voire diocésaine.
…
Les ressources bibliographiques et archivistiques…
Pour le Loir-et-Cher (41), nous avons la chance d’avoir le remarquable ouvrage du Docteur Frédéric Lesueur : Les églises de Loir-et-Cher, Paris, éditions A. et J. Picard, 1969, 318 pages, instrument très fiable, très complet, que tout le monde utilise dans le département. Même les notices explicatives des églises, dans les édifices eux-mêmes, sont généralement de simples reproductions des pages de ce travail. Les index y sont extrêmement pratiques et l’ouvrage est très confortable d’utilisation.
Page de droite, cathédrale Saint-Louis de Blois (41),
ancienne église paroissiale Saint-Solenne
lieu du mariage de Colbert
créateur pour Louis XIV de l’Académie des Sciences…
Page de gauche, l’église Saint-Nicolas, ancienne église Saint-Lomer de son abbaye…
Extraits du Frédéric Lesueur de mes parents…
et page de l’église Notre-Dame de Françay de leur mariage !
De très bons outils…
…
Pour l’Indre-et-Loire (37), le dictionnaire surnommé le Carré de Busserole, reste la référence, comme peut l’être le Célestin Port dans le département voisin du Maine-et-Loire (49).
Pour le département du Cher (18), il existe l’ouvrage de François Deshoulières, directeur adjoint de la Société française d’archéologie : Les églises de France, Cher, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1932, 282 pages. C’est un ouvrage classé par ordre alphabétique des communes, sans index des vocables. Il faut donc consulter l’ouvrage dans son entier pour faire une recherche à ce sujet. Il est incomplet et ne prend pas en compte les édifices disparus. L’ouvrage de référence dans le département reste un ouvrage assez ancien surnommé le Buhot de Kersers : Histoire et statistique monumentale du département du Cher, paru entre 1875 et 1898, qui reste une présentation plutôt touristique.
Pour le département de l’Indre (36), il existe aux Archives départementales de l’Indre (cote D656) un ouvrage tapuscrit de François Deshoulières : Les églises de l’Indre, ouvrage comparable à celui qui fut édité pour le département du Cher. Les ouvrages de référence pour le département sont aussi le dictionnaire d’Eugène Hubert, l’ouvrage de Mgr J. Villepelet : Sur les traces des saints en Berry, Bourges, Tarday, 1868, etc. (voir ma bibliographie pour l’église Saint-Pantaléon de Saint-Plantaire et celle de mes autres ouvrages dans ce département). Sur la spécialité de la toponymie, on doit signaler l’énorme travail de compilation de Stéphane Gendron : Les noms de lieux de l’Indre, publié avec le concours du Conseil général de l’Indre, édité par l’Académie du Centre et CREDI éditions, 2004, 544 pages, ouvrage qui souffre d’être trop linguiste et pas assez historien-géographe, ou préhistorien de faune éthique phonétique. L’ouvrage ne considère pas qu’un vocable d’édifice religieux est un toponyme. Étonnant non…
Pour le Loiret, c’est extrêmement laborieux, les Archives départementales ayant presque complétement disparu pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, après quelques essais organisés en Espagne… Je n’en connais aucun travail de synthèse complet, et il faut passer par les inventaires de l’ancien diocèse d’Orléans, et des anciens diocèses voisins de Bourges (voir mon étude sur l’église de Beaulieu-sur-Loire), de Sens, d’Auxerre…
Pour l’Eure-et-Loir, on peut dire que tout reste à faire et que la recherche dans ce domaine passe par les inventaires de ce diocèse, antérieurs à la Révolution, comme le Pouillé du diocèse de Chartres, et non par les recherches faites actuellement au niveau départemental qui peuvent cependant servir de vérification.
…
Départementalement portable et pratique pour le terrain…
la collection de Michel de la Torre.
…
Il existe de très intéressants travaux pour commencer à constituer ou pour vérifier ces listes de toponymes, d’édifices religieux, commençant par Saint-. Ainsi, nous avons à disposition le Dom Cottineau : COTTINEAU (Dom Laurent-Henri), Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, T. I et T. II, Macon : Protat, 1939, 2 vol., 3488 col. La collection des Villes et villages de France, constituée par département par Michel de la Torre, aux éditions Deslogis-Lacoste, se montre aussi particulièrement utile, tout comme un dictionnaire des communes, où qu’une bonne ressource cartographique, sachant que le cadastre ancien dit napoléonien ne donne pas les noms des édifices cultuelles paroissiaux, malgré le Concordat de 1801. C’est l’époque qui voulut cela… en bêtise cumulée.
Cette bêtise anticléricale se rencontre encore, même dans des travaux récents de doctorat, comme la thèse de doctorat de 2004 produite à l’Université Jean Moulin Lyon 3 : LE DIOCESE DE BOURGES AU HAUT MOYEN AGE DE SAINT URSIN A AUDEBERD (IVème s. – 1097), par Jacques PERICARD, sous la direction de Christian LAURANSON-ROZAZ (Thèse au format PDF) qui s’est refusé à écrire Saint- dans les noms de lieux et dans les vocables, ce qui rend cet outil et cette importante recherche ridiculement gauche, pour ne pas dire idiotement gauchiste. La recherche rapide par informatique s’en trouve ainsi pipée. Pour trouver un lieu Saint-Pierre, comme une église, voire une chapelle, dans l’ouvrage, il faut chercher « Pierre » et on se tape tous les noms d’auteurs avec ce prénom… C’est dire… En rappelant, ici, que des historiens sérieux ont démontré qu’Alexandre Dumas n’a pas pu écrire tout ce qui lui fut attribué, tout comme ont pu l’être les innombrables thèses de doctorat de Joseph Staline, Ben Lénine le champignon MST chauve, petit père du peuple qui veut faire des petits atomiques, et autres bla bla bla… terrorisant qui plaisent tant à ses dam(n)es.
HA HA HA à Aaaaah…
Si l’auteur plait aux dames, ça se vend…
que ce soit volé ou authentique, vrai ou faux…
voire en moqueries sadiques et vengeurs… et autres chinoiseries,
pour pimenter leurs délices criminels de leurs transgressions post-coloniales
Plus sérieusement, dans le Berry, il faut signaler la très importante compilation des procès-verbaux de visites de l’archevêque de Bourges, le cardinal de la Rochefoucauld, qui donne une bonne idée de l’exécrable situation au XVIIIe siècle avant la Révolution (Archives départementales 1 Mi 23), mais les vocables des chapelles ne sont pas toujours indiqués. Vous pouvez consulter une transcription de l’une de ces visites dans mon étude sur l’église Saint-Pantaléon de Saint-Plantaire en 1734, ou bien dans une de mes autres études berrichonnes.
Si on veut s’attaquer aux mentions plus anciennes dont il faut comprendre le contexte (voir mon article à ce sujet : La latinisation médiévale des toponymes), il faut consulter les Pouillés, documents fiscaux des diocèses, et les sources anciennes des Archives départementales, voire même les sources des Archives Nationales.
Si on veut vraiment faire un travail sérieux, c’est beaucoup plus compliqué…
et surtout beaucoup plus long en matière d’apprentissage.
Pour mes recherches toponymiques sur tout le territoire français, j’utilise surtout : CDIP : Dictionnaire des toponymes de France, recherche et localisation de lieux en France, 2 CD-Rom, Bouffemont, CDIP, 2004, et les données du Net qu’il faut vérifier. Cet outil informatique très précieux qui reprend les données IGN (Institut national de l’information géographique et forestière, à retrouver sur Géoportail) ne comprend presque aucun nom de rue, ruelle, impasse, place de milieu urbain, et peu de vocables d’édifices religieux (pauvreté documentaire toujours issue de l’anticléricalisme républicain d’origine terroriste anglo-saxonne et américaine, voire prussienne et protestante après 1870 pour en servir l’Empire ottoman indo-chinois) et reste donc très incomplet pour une recherche sur les toponymes Saint-, en indiquant aussi que les lieux-dits enregistrés sont assez peu nombreux par rapport à ce que peut donner parfois le cadastre ancien dit napoléonien. Une carte IGN peut donner une trentaine de noms, alors qu’un cadastre peut en livrer quelques centaines. Le terrible record que j’ai personnellement eu à traiter dans mes études sur les toponymes pour les municipalités fut celui de la commune de Tillières dans le Maine-et-Loire (49) en limite de la Loire-Atlantique : 850 toponymes relevés sur son cadastre pour 2413 hectares, sachant en plus qu’une partie des anciens toponymes manque à cause d’un remembrement qui effaça nombre de noms de parcelles, et sachant que les guerres franco-anglaises, les Guerres de Religion et les Guerres de Vendée (toutes guerres franco-anglaises bricolant dans les deux camps…) ont presque totalement détruit les archives anciennes.
Pour illustrer la difficulté de réaliser ces inventaires des lieux Saint-, je dois avouer que, dans mes recherches sur le culte du petit saint Cyr et de sa mère sainte Julitte, pour Saint-Cyr-en-Bourg en Maine-et-Loire (49), lors de mes vérifications de terrain, j’ai découvert un toponyme Saint-Julitte dans l’Indre-et-Loire que je n’avais pas cartographié, lors de ces recherches, un ancien établissement religieux massacré qui portait géographiquement la mémoire d’une clairière isolée au milieu des bois, lieu de tortures romaines de frontière antique. Que « dis euh… » me pardonne… Sans doute y trouve-t-on actuellement quelques brûlures de vos antes (h)aines… Une photo ? Alors halle hors a l’or à Laure… Mais mémé met mes mets…
C’est à cause des deux ailes…
car elle cuit cui-cui…
Sain te jus lie… T’oeufs… ? Sainte-Julitte ? R’aises Y c’temps ce…
Une forêt en forme de fer à cheval en amas zone… Amazon(e) ?
Sainte-Jullite en Indre-et-Loire (37)
À voir et à revoir sur Géoportail et sur le terrain…
T’es reins ???
…
Une commune ôtée, anciennement hottée et hôtée…
Sainte-Jullite en Indre-et-Loire (37)
À voir et à revoir sur Géoportail et sur le terrain…
T’erres hein ???
…
Vois ton agglutination péri-urbaine… sur voie, voix, romaine…
Sainte-Jullite en Indre-et-Loire (37)
À voir et à revoir sur Géoportail et sur le terrain…
Terrain Hun ???
Poisons à la place des poissons ?
…
Alors…
((((( ! )))))
¿ Entonces ?
¿ Antena ou antennes ?
Ant ten ?! avec les dix doi(g)ts de la Reine Victoria…
parce que, avec ses philosophes, et autres colporteurs « militaires »,
on doit constater que, comme toutes aujourd’hui,
ça la grattait sous la soie… indo-chinoise.
Saluons, quand même ici, le courage de ceux qui essaient, souvent vainement sur le Net, d’établir la liste de tous ces vols, pillages, meurtres, massacres, usurpations… Je crois qu’ils prennent quelques risques.
Restes de récupération d’art français, dit gothique,
de l’établissement religieux de Saint-Jullite,
paroisse amalgamée à Saint-Flovier (37).
Photo Nicolas HURON
…
Merci à Jose Luis Campos pour Montornès del Vallès d’avoir osé…
et pour qui je prépare une petite surprise cognitive de faune éthique phonétique…
Mais, à sa demande par courriel sur la justesse de sa comptabilité, je répondrai que sur
les « 400 lieux de culte au total entre la France, la Catalogne et le nord de l’Espagne »
et sur les « 260 lieux de culte dans toute la France » consacrés à Saint-Saturnin
et inventoriés par ses soins, je peux affirmer qu’en Loir-et-Cher, chez moi,
le docteur Frédéric Lesueur en a inventorié avec certitude 6 :
Blois, Chissay, Conan, Courbouzon, Neuvy, Pouillé.
Xi-C, Conne-an ; Courbe-ouzon, Nœud VI…
Et que pour les autres départements…
J’ai la faiblesse de croire qu’ils ne sont pas dépourvus d’habitants religieux… Non ?
…
Dommage que le congélateur n’avait pas été inventé avant votre épisode napoléonien…
Sinon j’en aurais souhaité quelques mets espagnols épluchés sur vos portes de granges
pour les enterrer honorablement par chez moi… même sous forme osseuse.
Viva ! l’Halle j’ai ri… et vive la Corse libre (des Corses évidemment…) !
¡ Libertad para Cataluña !
…
Pour en finir avec quelques efforts inutiles sur ce média, je vous présente
mon formateur informatique en vadrouille à Barcelone…
qui ne comprend pas vraiment le français…
un ch’ti… de Lille, l’ill, l’île, lie Leu…
un lien à suivre… une vraie tuerie
que je conseille vivement.
Moi, ça m’a coûté…
3500 € pour rien…
investi se ment…
¿ Gratte huis ?
Olivier Roland qui a sans doute abondamment pensé à Roncevaux,
au lit vie est, au Jardin des Oliviers, et aux rôles en… comptabilités.
Avec sa tête de mustélidé, je souhaite bon courage à tout le monde…
sachant que son équipe est parfois canadienne…
qu’est bec du Québec comme son nez…
J’ai commencé à restituer ces savoirs…
et vous ? Toujours pillards ?
D’autres « réfugiés » à venir ?
Tousse en sang bleu !
Osez l’Histoire !
Reconquista ! Re con quête !
…
Recherches utilisées pour trouver cet article : wordpress